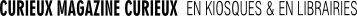


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


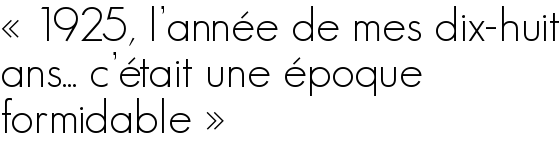
 |
|
|
Publié dans le
numéro 016 (Avril 2012)
|
Entretien avec Yvonne F., 104 ans (1/2).
Propos recueillis par Emilie Giaime et Thibault Camus.
L’entretien a lieu dans
l’appartement de deux-pièces où elle vit depuis 1939, rue du Cherche-Midi, à Paris.
La deuxième partie de cette rencontre est publiée dans le numéro 18 du Tigre.
Attention à ma chaise, parce qu’elle a quatre-vingt deux ans ! Elle n’en peut plus. Elle a été rafistolée je ne sais pas combien de fois.
Elle a quatre-vingt deux ans...
Eh oui, y a eu quatre vingt deux ans au mois de janvier que je suis dans l’immeuble. D’abord au rez-de-chaussée pendant dix ans et ici, au dernier étage, ça fait soixante-douze ans.
Vous êtes née à Paris ?
Je suis née à Paris, mais je n’ai pas été élevée à Paris. Mes parents étaient serviteurs dans une maison bourgeoise du dixième arrondissement. Il fallait qu’ils se placent, ils venaient de la campagne. Et mon père était l’aîné d’une famille de treize enfants ! Alors j’aime mieux vous dire qu’il fallait déguerpir. Il fallait une volonté de fer pour survivre à tout ce qu’ils ont vécu. C’était des gens qui avaient été tellement pauvres - pas pauvres d’esprit, si vous voulez, mais matériellement pauvres - ils avaient tellement souffert de la guerre, ils avaient vu tellement d’horreurs qu’il n’était pas question de faire un caprice. On n’était jamais plaint, quoi qu’on ait il fallait marcher. Mon père m’a dit - et je l’ai cru, je le crois toujours - qu’en 1914 il avait laissé du pain dans le placard en partant à la guerre. Eh bien quand il est revenu en 1918, à l’Armistice, il l’a retrouvé, il l’a fait tremper et il l’a mangé.
Mes parents travaillaient et ils ne pouvaient pas m’élever, ils ne pouvaient pas me garder, alors j’ai été mise en nourrice à ma naissance. C’était très répandu, les nourrices venaient de province dans les maternités et elles prenaient les enfants dont les mères travaillaient. Il y a très longtemps que les femmes travaillent ! C’est pas seulement de maintenant. Les femmes du peuple en tout cas - même s’il y en avait d’autres qui travaillaient, les intellectuelles, mais ce n’était pas répandu. J’ai été mise en nourrice de ma naissance jusqu’à l’âge de huit ans à Les Riceys, en Champagne, près de la Côte d’Or. Mon papa nourricier était jardinier. Les premières fleurs dont je me souviens, ce sont les violettes et les pensées. Ça sentait bon dans mon jardin... J’ai toujours gardé ça, les souvenirs. Il faut faire de beaux souvenirs aux enfants, parce que ça reste toute la vie. Toute la vie, quoi qu’il arrive par la suite - parce qu’on a des pépins, plus ou moins graves mais il y en a, en un siècle ! Eh bien les souvenirs d’enfance, ça reste et ça illumine.
Et vous, votre plus lointain souvenir ?
Eh bien c’est un jardin. Je suis avec ma mère, je dois avoir quatre ans, et il y a une photographie de ce moment : j’ai mon petit nœud sur le côté, mon petit ruban, on voit ma culotte en dessous avec des volants brodés (elle rit). Je ne sais pas qui l’a prise car il fallait un photographe, les gens n’avaient pas d’appareils. Une fois par an, mon père m’emmenait chez un photographe dans la région. On prenait le train, pour aller très peu loin certainement, mais quelle aventure ! Et je crois que ça vient de là : j’ai la passion des trains, des locomotives surtout. Je ne sais pas pourquoi, je crois que c’est la puissance : quand un train arrive dans une gare, c’est extraordinaire... Vous voyez cette masse qui arrive. Et bien ça date de mon enfance. A cette époque il y avait deux compartiments, l’hiver il y avait un poêle, des bancs de chaque côté et tout le monde attendait, on était là assis les uns en face des autres et il y avait le gros calorifère qui chauffait. Et puis il y avait une petite passerelle, on pouvait sortir et se tenir à la rambarde, on voyait le paysage. Pour moi c’est resté un souvenir extraordinaire. Je devais avoir cinq, six ans.
Vos parents vous rendaient visite ?
Oui oui, ils venaient une fois par an.
Pour les vacances ?
Non, pensez-vous ! Il n’y avait pas de vacances à l’époque. Ils venaient quand on leur donnait l’autorisation. Vous savez, quand on est placé, c’est les maîtres qui commandent. Faut demander l’autorisation pour tout. Ils venaient une fois par an, chacun leur tour. Pour moi, c’était pas... C’était des étrangers. C’est ma nourrice qui était ma maman, pour moi. Elle s’appelait Berthe, maman Berthe. Et quand j’ai eu huit ans, ma mère ma reprise et elle m’a tabassée pendant quatre ans. Elle ne m’aimait pas. Ça arrive, les mères qui n’aiment pas leur enfant. Mais enfin, la vie était tellement dure pour elle aussi. Et des fois peut-être que je l’énervais (elle rit doucement). Et puis il y avait la mentalité des gens parce qu’au fond, ma mère, c’était une fille-mère, elle n’était pas mariée. Mais tout le monde l’aimait bien, la Pauline, parce qu’elle était très courageuse. Donc elle m’a reprise, j’avais huit ans, et on est allées dans la Sarthe, pensant que ce serait mieux qu’à Paris - c’était le début de la première guerre, beaucoup de femmes travaillaient dans les usines pour faire des obus. Et c’est là que les femmes commençaient à se libérer, parce que les hommes étaient partis. A la campagne, c’étaient elles qui élevaient les enfants, qui labouraient la terre, qui conduisaient les chevaux... C’était ça. Et les enfants travaillaient, il fallait aider, désherber, récolter, tout se faisait à la main, on n’avait pas de machine. A la campagne, de quoi vivaient-elles, les femmes seules ? Elles allaient en journée faire des lessives, travailler dans les champs. Moi j’allais à l’école l’hiver et je n’y allais pas l’été, parce que ma mère avait pris des enfants en nourrice elle aussi. L’hiver, elle était à la maison parce qu’il n’y a rien à faire dans les champs, alors j’allais à l’école ; et puis l’été, quand elle était partie travailler, c’était moi qui gardais les enfants. Alors j’étais libre, je n’allais pas à l’école mais ça ne me gênait pas. Je voyais mes amies partir, revenir, bon ben moi ça ne me faisait rien.
Mais comme elle me tabassait, un jour je suis partie. J’avais onze ans, je suis partie pieds nus, j’ai été chez mon oncle, chez les paysans - tiens, ils sont là (elle montre sur la cheminée une photo d’hommes et de femmes au travail dans un champ). Ils n’habitaient pas très loin mais il fallait y aller quand même ! Disons que c’était à deux kilomètres. Puis il y a eu, pas un procès, mais c’est passé au tribunal et c’est mon père qui a eu ma garde. Et comme il ne pouvait pas me garder parce qu’il était célibataire, c’est mon oncle qui a été chargé par le tribunal de me garder. Alors là je suis allée à l’école, j’ai passé mon certificat d’étude et puis, attendez voir... oui, j’avais treize ans, j’étais en retard d’un an : à treize ans je suis partie, mon père m’a reprise et il m’a emmenée chez sa mère à Orléans. C’est comme ça que j’ai connu ma grand-mère paternelle qui avait soixante et onze ans. Dès que je suis arrivée chez elle, on m’a fait faire les carreaux. Oui... Oh elle était très gentille avec moi. Tout de suite elle m’a montré comment coudre et je me suis débrouillée. J’ai vécu avec elle quatre mois, elle est morte en octobre. Quand elle est morte j’ai été chez des cousines qui étaient couturières et j’ai appris la couture - avec mon père, il fallait pas que ça dure longtemps, il fallait apprendre vite, hein ! Parce qu’il payait ma pension. A ce moment là, la France était libre, il avait appris son métier, il était pédicure et masseur, ce qu’on appelle un kinési. Il s’est débrouillé tout seul : pendant la guerre il était dans le service de santé, brancardier, il ramassait les morts, il ramassait les blessés. Il a connu beaucoup de médecins comme ça et c’est avec l’aide de ces médecins qu’il a appris. Il faisait les gardes de nuit, il était infirmier. C’était un caractère... Sacré caractère. Il fallait ramper, sinon il vous cassait. De toute façon c’était une époque où on ne cajolait pas les enfants. Les enfants étaient élevés très strictement - même chez les bourgeois, on n’embrassait pas les enfants.
Quand j’ai eu quinze ans, je savais coudre, je suis revenue à Paris et il m’a placée comme bonne d’enfants dans une famille noble, dans le septième arrondissement. Il y avait quatre enfants, et moi je m’occupais d’une petite fille qui avait quatre ans et demi. Elle mangeait avec ses parents et ses frères et sœurs dans la salle à manger et je me souviens que des fois, tout le monde était réuni, j’étais debout à côté d’elle et elle disait : « Maman, est-ce que vous donnerez du dessert aux bonnes ? » (Tic tac de la pendule) Eh bien je me vengeais le soir ! Je lui faisais manger son potage et au lieu de lui mettre une assiette propre pour son petit suisse, je lui retournais son assiette et hop, elle mangeait sur l’autre côté ! « Maman, est-ce que vous donnerez du dessert aux bonnes »... à quatre ans et demi, vous vous rendez compte ? Elle avait pas à s’en faire parce que la cuisinière, quand elle faisait une tarte pour les patrons, elle en faisait une aussi pour nous ! Mais j’étais heureuse, je me promenais dans les Invalides.
Vous aviez du temps libre ou vous étiez toujours avec les enfants ?
Oh non, on n’a pas de temps libre quand on est placée. Si, on avait un après-midi tous les quinze jours, le dimanche. On était trois, la cuisinière, la femme de chambre et moi, alors c’était chacune son tour. J’habitais chez eux, au dernier étage, une chambre sans feu, sans eau, il y avait l’eau dans le couloir. La femme de chambre dormait en bas, c’était deux grands appartements avec de grandes fenêtres qui donnaient sur la rue de Bourgogne, entre la chambre des députés et le musée Rodin. Et la dernière fois que je suis passée devant (mais maintenant je ne peux plus parce que j’ai du mal à marcher), je me suis dit : « Quand même, ces fenêtres, dire que c’est moi qui les faisais ! » Alors quand j’avais l’après-midi, je venais chez mon père qui habitait rue de Buci à Saint Germain des Prés, et puis à la fin du mois j’apportais mon billet de cent francs que j’avais gagné. Il s’était marié avec une Savoyarde d’origine italienne, du Piémont, Ernestine elle s’appelait. Elle était très gentille avec moi. Bah on se voyait peu, mais après j’ai vécu avec eux parce que j’ai appris le métier de coiffeuse. Je ne suis pas restée bonne tout le temps, c’était le temps que mon père se marie parce qu’étant célibataire, il n’avait pas le droit de m’avoir avec lui...
Les pères célibataires, ils ne pouvaient pas avoir la garde de leurs enfants ?
Ah non, non.
Parce que vous étiez une fille ?
Oui, peut être qu’un garçon ça aurait été différent... Mais moi je n’avais pas le droit. Alors c’est comme ça que j’ai été placée pendant un an, le temps qu’il se marie. Et puis mon petit frère est né, Max. On avait seize ans d’écart. Mais il est mort avant moi, vous voyez... Eh oui. Et j’ai appris le métier de coiffeuse, qui n’avait rien à voir avec ce qu’il est maintenant. C’était le début où les femmes se faisaient couper les cheveux. 1925, mes dix-huit ans, c’était une époque formidable... Formidable ! Quand je rentrais à la maison c’était différent, c’était calme, mais dès que je sortais c’était formidable. Mon père, je le respecte, parce que c’était un caractère extraordinaire, mais il fallait subir. Ma belle-mère était très gentille mais elle était calme, elle était triste. Elle s’ennuyait à Paris, elle n’avait pas ses montagnes. Alors moi j’étais pas beaucoup à la maison puisque je travaillais. Le dimanche on allait à la messe, on allait aux vêpres et puis on rentrait. J’aimais bien les vêpres et la messe parce qu’il y avait les grandes orgues, j’allais à St Sulpice ou à St Germain des Prés. J’ai été au théâtre pour la première fois, au Châtelet, à dix-huit ans : on avait une concierge dont le mari avait des billets et un soir elle est montée demander la permission à mon père de m’emmener au théâtre (j’avais 18 ans !) : on a vu Le Tour du monde en quatre vingts jours... Alors avec ça, je risquais pas de faire des mauvaises rencontres ! Mais j’étais contente, il y avait de la musique. C’était varié : le théâtre, la messe, le salon de coiffure... (Elle rit)
Ces années là, 1923-24, c’est là où la femme s’est libérée des corsets, de tout ce falbala qu’elle avait dessous, les jupons et tout ça. Encore que les jupons, ça a duré quand même mais après on appelait ça des « combinaisons ». Les femmes se sont fait couper les cheveux, alors là c’était extraordinaire. Mais moi j’ai dû attendre ma majorité, parce que mon père ne voulait pas. Alors je faisais le métier, mais j’avais le chignon...
C’était mal vu de se faire couper les cheveux ?
Au début, on disait que c’était pas sérieux, que c’était des femmes de mauvaise vie... Je travaillais comme coiffeuse, les clientes me disait «Mais mademoiselle Yvonne, pourquoi vous n’avez pas les cheveux coupés, vous ?». J’étais obligée de raconter mon histoire, que mon père ne voulait pas. Pourquoi ? Je ne sais pas, surtout que je travaillais en bas de l’immeuble où j’habitais, alors j’allais pas faire la vie de patachon dans l’escalier sous prétexte que j’avais les cheveux coupés ! C’était un peu arriéré comme idée, quand même. Alors j’ai gardé mon chignon jusqu’au jour de mes vingt et un ans. C’était un dimanche, mon anniversaire. Ils sont allés tous les deux, ma belle-mère et mon père, promener le petit frère au Luxembourg et pendant ce temps-là j’ai fait mon baluchon et je suis partie. Le lundi, je ne travaillais pas, le mardi j’avais les cheveux coupés et le 12 janvier, j’étais mariée. C’était un samedi : en quinze jours, tout était réglé.
Vous l’aviez rencontré quand, votre fiancé ?
On se fréquentait depuis 1926, on s’est mariés en 1929. Je l’ai connu dans l’immeuble, c’était un voisin...
Vous voyez qu’il se passe des choses dans l’escalier !
Mon père le connaissait depuis qu’il était enfant. Et c’est drôle parce qu’en 1915, quand je suis revenue pour la première fois à Paris, ma mère m’a dit « Va jouer dans la cour ». Il y avait trois enfants qui discutaient dans la cour, deux garçons et une fille. Et bien l’aîné des garçons, c’était lui, Roger - et la fille, c’était sa sœur. C’est curieux, j’avais huit ans à l’époque et je ne pensais pas qu’un jour se serait mon mari. Ce qui m’avait marquée, c’est qu’il avait une veste avec une martingale : j’avais jamais vu ça, c’était pas la mode à la campagne. C’est drôle les souvenirs qui vous restent... Et c’est curieux parce qu’on s’est connus pendant cinquante ans, on a été mariés quarante-sept ans, on aurait pu en parler, de ce souvenir, mais ça ne m’est jamais revenu, ça ne m’est revenu qu’après sa mort. Mon mari avait perdu sa mère très jeune, elle avait quarante-quatre ans. Alors mon père disait toujours : « Ah la la, ces enfants, ce qu’ils sont sérieux ! Les garçons c’est des travailleurs et la fille, elle s’occupe bien de l’intérieur » - ce qui était vrai. Et puis du moment où il a voulu me fréquenter, c’était plus rien. C’était trop, avec un caractère comme ça, on ne pouvait pas s’entendre. J’ai obéi jusqu’à ma majorité et puis après hop, je suis partie. Du jour où j’ai quitté la maison, je n’ai plus jamais revu mon père. Entre la rue de Buci et ici, la rue de Sèvres où on est venu avec mon mari en 1929, j’ai bien dû le croiser une fois ou deux, mais c’est tout. Plus tard j’ai su qu’il était parti en Savoie d’où était originaire ma belle-mère. Et quand il est mort, mon frère m’a recherchée - c’était pas difficile de me trouver. Je n’ai jamais revu ma mère non plus, depuis mes onze ans. Elle aussi s’était mariée et ils ont quitté le pays. Je suis retournée voir ma nourrice une fois mariée, je ne l’avais pas revue depuis l’âge de huit ans. Ça a été une joie... Mais beaucoup de choses avaient changé. Ils avaient eu trois garçons et c’est le seul qui est allé à la guerre qui a vécu, les deux autres sont morts. L’aîné est mort à l’armée pendant le service civil - à l’époque, il y avait trois ans de service militaire. Il est mort d’un accident de cheval. Je me rappelle de son enterrement, je devais avoir... cinq ans ? Non, moins parce que j’étais encore dans mon lit en fer blanc avec des rideaux. A cet enterrement, il y avait deux corbeilles avec des fleurs jaunes dedans et les gens venaient, prenaient des fleurs. J’avais trouvé ça... ça m’avait impressionnée. Eh bien j’ai su ce que ça représentait soixante ans plus tard, quand on a eu la maison à la campagne : un jour je vois ces fleurs là chez un voisin alors je lui explique ce qui s’était passé et je demande ce qu’elles représentent. Il m’a dit que c’était parce que c’était un enterrement civil. Alors voyez le temps qu’il m’a fallu pour comprendre ! Et le deuxième fils de maman Berthe, André, est mort en 1918 de la grippe espagnole. Ça, ça a fait des ravages, plus encore que la guerre.
Quand vous vous êtes mariée, vous avez continué à travailler ?
J’ai travaillé au salon jusqu’en 1938 : je me suis disputée avec le patron et je suis partie. Il m’avait dit « Il faut que vous appreniez la coupe de cheveux » - parce que les femmes venaient se faire couper les cheveux mais il n’y avaient que les garçons qui savaient couper. Alors j’ai appris. Mais peut-être que les garçons coiffeurs ont râlé parce qu’ils avaient le pourboire et ils avaient chacun leur clientes, enfin je ne sais pas mais un jour j’ai dit : « Ecoutez, quand même vous m’avez obligé à apprendre la coupe de cheveux et vous continuez à me faire faire des shampoings ! » Et puis on travaillait au fer, à ce moment là. C’était le début des permanentes avec des pinces, et dans ces pinces il devait y avoir de l’électricité. Oh, c’était toute une installation ! Mais moi j’avais envie de couper, et à la fin j’ai claqué la porte.
Vous étiez payée comment ?
Toutes les semaines en liquide, on avait un fixe, trente-deux francs par jour plus les pourboires - les pourboires étaient rares, c’était cinquante centimes le plus. Mais j’avais une cliente qui me donnait cent francs : c’était une dame qui était la femme d’un écrivain. Elle habitait rue Saint André des Arts, passage du Commerce. Vous connaissez le passage du commerce ? C’est très connu, c’est là qu’a habité Danton. Elle était d’origine italienne, elle avait été dame de compagnie de ce monsieur, elle avait sept enfants et il l’avait épousée. Alors elle allait dans les réceptions et elle venait se faire coiffer - et elle me donnait cent francs ! Vous vous rendez compte ? L’équivalent de trois jours de travail. Mais je n’ai jamais su le nom de l’écrivain, je sais juste qu’il était à Saint Germain des Prés. Aux Deux Magots, c’était uniquement les écrivains. Aujourd’hui c’est rastaquouère un peu quand même, avec ces terrasses, tout cet argent... C’est pour les touristes. Mais avant c’était très, très célèbre. C’était un village. On me connaissait, on m’appelait par mon prénom - ben oui, j’ai travaillé sept ans quand même ! Il y avait une petite échoppe devant le salon, on vendait des pots de crème, des boîtes de poudre de riz, des épingles à cheveux ; le patron gardait ça et quand il était occupé, c’était moi. Alors forcément, on connaît les commerçants. Saint Germain des Prés, c’était les écrivains et Montparnasse, c’était les peintres.
Vous alliez à Montparnasse ?
Oh non. On restait dans son milieu, on se mélangeait pas. Mais ils avaient une renommée. C’était une époque heureuse.
Et vous faisiez la fête ?
Oh non, on faisait pas la fête ! Mais avec mon mari, on sortait beaucoup. Il adorait le théâtre. Il était électricien de son métier, à cette époque il travaillait chez Saunier-Duval, une maison qui existe encore. Et il est entré comme électricien à l’Opéra en 1938, là il était dans son élément. Et on allait danser, rue Cognacq-Jay c’était une salle de bal, on dansait la valse, les one-step et même le charleston. Moi j’adorais la valse... C’était en journée, on allait rarement danser le soir. Je me souviens d’une fois, on a été au Moulin Rouge avec mon mari, sa sœur et son beau-frère, et on a dansé jusqu’à tellement tard qu’il n’y avait plus de métro pour rentrer. Eh bien on s’est assis sur un banc, on a mangé des saucisses chaudes et puis après on est revenu à pied, on est passé par les Halles et c’est comme ça que j’ai vu arriver le train, l’Arpajonnais. C’était un train qui venait d’Arpajon et qui apportait les légumes frais tous les matins aux Halles. Et on allait beaucoup au cinéma, on avait le cinéma muet, il y avait même des films à épisodes : ça durait quatre semaines par exemple, on allait voir les épisodes, il y avait un pianiste qui était assis devant l’écran puis il tapotait, des fois ça n’avait aucun rapport avec le film mais ça faisait rien. Ben oui, c’était comme ça. Et les premiers films parlant datent de 1931. Au début, le cinéma parlant, c’était nasillard... Moi je n’ai pas vu le premier film, j’ai vu le deuxième, sur les grands boulevards, au Grand Gaumont. C’était un film avec Marie Bell, une comédienne de la Comédie-Française, je crois que ça s’appelait « La route est à nous ». Alors y en avait, des distractions... Jusqu’à la guerre : là, ça a été fini. Là, on cherchait à manger. C’était une autre vie. Des Allemands, y’en avait partout. Tous les hôtels du quartier en était plein, le Lutetia (###Hôtel de luxe situé sur le boulevard Raspail, le Lutetia a été réquisitionné par les services du contre-espionnage allemand pendant la seconde guerre mondiale###) en était plein, c’était l’espionnage. Et il y avait la prison du Cherche-Midi, on les voyait, les prisonniers, quand on allait au marché on les voyait, ils étaient aux fenêtres. Ici, fallait tout camoufler (elle montre la fenêtre qui donne sur un jardin). Les carreaux étaient bleus, on mettait des papiers collants aux fenêtres pour les bombardements, pour éviter que les carreaux éclatent. Ça fait qu’on n’avait pas besoin de rideaux !
Vous étiez déjà dans cet appartement ?
Oui, on était là. On y est entré le 1er janvier 1939. Ici (le salon où nous sommes) c’était le débarras, il n’y avait rien, pas de chauffage, c’était la cheminée mais ça ne chauffait pas grand chose. Je vivais avec mon fils Michel, qui est né en 1934, dans la cuisine et la chambre. On dormait tous les deux, comme ça on se tenait chaud. Parce que il y avait le charbon, mais le charbon il fallait quand même l’acheter. Un jour, vers midi, je me souviens que j’étais en train de donner à boire à Bernard, mon deuxième fils qui était bébé, quand ils ont bombardé la rue du Cherche-Midi. Il y a une employée du Bon Marché qui rentrait chez elle déjeuner, elle a été tuée. Il y a eu des démolitions, là, partout dans la rue. On aurait été à la fenêtre, on la recevait dans la tête. Mais Paris n’a pratiquement pas été bombardé, c’est dans les environs qu’il y a eu des bombardements terribles... Quand on descendait s’abriter dans les caves, les ampoules tremblaient alors que la bombe était tombée depuis très longtemps. C’est ce qui nous a fait changer d’avis d’ailleurs, alors après on allait au métro Vaneau - c’est profond un métro. Le courant était coupé, on s’asseyait sur les rails quand on avait de la place, les Allemands étaient déjà là, ils étaient assis, ils avaient pris les bancs. Tous les soirs on descendait, chacun avait sa petite mallette avec quelques bricoles, Bernard était tout petit alors j’avais du rechange, j’avais le biberon, j’avais les quatre sous qu’on avait, parce que c’était vite compté. Alors tous les soirs vers onze heures ils allaient bombarder je sais pas où et je faisais lever Michel, je l’habillais, mais le temps que je prépare Bernard, que je l’enveloppe, Michel était recouché ! (Elle rit) Le théâtre commençait à six heures du soir - pas huit heures comme aujourd’hui - alors mon mari rentrait à dix heures du soir, il ne se déshabillait plus. On attendait... Si bien qu’à la fin, j’ai dit : « C’est terminé, on ne descend plus. Tu rentres, si tu veux prendre une collation, prends une collation - c’était vite fait parce qu’on n’avait rien à manger - puis on se couche et on prend les enfants avec nous. Et s’ils bombardent, eh bien on mourra tous ensemble ». Et c’est comme ça qu’on a fini la guerre. Non, quelle corvée de descendre quand même, et puis fallait pas avoir de lumière, fallait pas trainer dans les rues, fallait rien faire, oh ! Quand l’alerte sonnait, fallait que tout le monde soit aux abris. L’hiver, il n’y avait pas d’alerte, c’était dès qu’arrivait la belle saison, quand la nuit est claire vous savez.
On achetait le journal pour voir le jour des distributions de denrées. On avait soixante-dix grammes de viande par semaine... Non, attendez, c’était soixante-dix grammes sans os et cent grammes avec os. Quand Bernard est né, en 1943, j’ai eu droit à du lait, le pharmacien m’a toujours donné du lait condensé. On avait des cartes de rationnement : y avait les J1, les petits, J2 c’était les enfants de onze-douze ans (c’était Michel), après c’était les J3, les gens de quinze-seize ans, puis les adultes et enfin les travailleurs de force, qui avaient cent cinquante grammes de pain par jour au lieu de cent grammes. C’était vraiment restreint... Pourtant au marché noir il y avait de tout si vous aviez de l’argent. Certains n’ont jamais manqué de rien. On connaissait des gens qui étaient fourreurs, ils avaient du poulet, ils avaient de tout. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient une monnaie d’échange : contre la nourriture ils donnaient de la fourrure. Et tout était comme ça. A la campagne aussi, je le voyais, il y a des paysans qui se sont enrichis parce que les gens avaient faim. Ils profitaient de ça.
En 1943, c’était « l’année noire » : on sentait que c’était la fin de la guerre... mais ça continuait. A la naissance de mon deuxième fils, j’ai abandonné le travail : je ne pouvais pas être chez moi pour couper les cheveux de mes clientes et aller faire la queue pour avoir de la nourriture. Mon mari n’était jamais là, puis il est parti au mois d’août 1944, comme tout le monde - pas pour longtemps puisque la guerre a été finie au mois de juin suivant. Pour gagner quelques sous, je tirais l’aiguille toutes les semaines avec ma concierge parce qu’il y avait une maison qui vendait des draps et des torchons là, en bas, et les institutions religieuses refaisaient tous leur stocks et venaient se fournir ici. Il fallait faire les ourlets aux torchons, aux draps, tous les trousseaux. On a même cousu des surplis de prêtre ! Oh j’aimais bien ça parce qu’il y avait de la dentelle et il fallait coudre très, très fin, et moi j’adore le beau travail. On donnait la toile à ma concierge, elle coupait la toile, elle piquait à la machine et moi je faisais toutes les coutures rabattues, toutes les finitions, les surjets. Eh bien je gagnais mille francs par semaine et de temps en temps, j’allais les dépenser pour acheter du beurre : au marché noir, le beurre valait mille francs le kilo ! J’en achetais à une dame qui habitait l’immeuble, qui était femme de chambre à l’hôtel du Louvre où descendait des Belges - les Belges n’ont pas fait la guerre puisque le roi avait capitulé. Et bien les Belges apportaient de tout et ma voisine rapportait du beurre. Mais c’est fou, quand on a rien comme ça et puis qu’on a quelque chose, si peu que ce soit... On n’avait pas de savon, le savon c’était de la graisse de bœuf.
Ça nettoie, ça ?
Oh ben pensez-vous ! Les tâches restent. Ça nettoie un peu le linge mais ça mousse pas. C’était de la graisse de bœuf avec de la potasse, mais je me rappelle que les chemises de bébé de Bernard, c’était gris. Et puis un jour mon mari me rapporte un tout petit morceau de savon qu’il avait trouvé. Du vrai savon ! Un savon qui était resté là, un oubli, personne ne l’avait vu apparemment. Et puis de l’eau de javel, un fond d’eau de javel. J’ai nettoyé les chemises de Bernard qui sont devenues blanches comme tout ! Quel bonheur (Elle rit). Eh bien on en était là.
Toute cette période, c’est pas un bon souvenir mais ça s’estompe, après, pour nous qui n’avons pas eu de décès dans notre famille. Pour ceux qui ont connu des problèmes humains, c’est pas pareil, parce qu’il y a eu des atrocités. A l’époque, on n’était pas renseignés sur ce qui était fomenté par les Allemands. On ne le savait pas. Mais en haut lieu, ils le savaient : les voix qui auraient pu s’élever, comme le Pape par exemple, n’ont rien dit. Nous, on l’a appris à la fin de la guerre, quand les journaux ont paru avec les photos abominables. C’était incroyable, une telle cruauté dépassait l’entendement. Mais sur le moment, on n’en parlait pas dans la presse. Pour les nouvelles, il fallait avoir Londres. Les Allemands brouillaient l’antenne, j’appelais ça « la crécelle ». Certains soir, pourtant, on l’avait très bien, très clair : c’était la France qui parlait aux Français : « Ici Londres »... C’était sur un vieux poste, on se mettait dans la chambre et c’est comme ça qu’on avait des nouvelles. Et il y avait le téléphone arabe, j’avais quand même des clientes qui étaient renseignées. C’était une époque où il fallait toujours se méfier parce qu’il y avait des dénonciations : si vous étiez juifs, communiste, ou même si on vous en voulait pour quelque chose vous pouviez être dénoncés. Ça existait.
Vous avez connu des gens qui ont été arrêtés, déportés ?
Non, moi non. Mais on craignait quand même les Allemands : il fallait pas grand chose pour avoir des ennuis. Une fois, un des électriciens de l’Opéra, un copain de mon mari, rentrait chez lui à bicyclette un soir après le travail. A minuit, il ne devait pas y avoir grand monde sur le boulevard... et il a bousculé un Allemand. Sans doute qu’il y a quelque chose qui a vrillé, sa roue a touché un Allemand. Alors je ne sais pas au fond ce qui s’est passé, peut-être que l’Allemand a porté plainte, en tout cas l’électricien a été emprisonné à Troyes dans la prison des condamnés à mort pendant dix mois. Oui... Alors tout le monde se demandait « comment on va pouvoir le sortir de là ? ». Mon mari, avec une délégation d’électriciens, a été trouver une cantatrice qui était Alsacienne et connaissait Stülpnagel, un commandant allemand de la place de ParisStülpnagel, un commandant allemand de la place de Paris [1]. C’est comme ça qu’on l’a fait libérer.
Vous étiez où, à la Libération ?
A la Libération j’étais absente de Paris, j’étais à la campagne avec les enfants, à Tuffé dans la Sarthe, dans ma famille maternelle. Je l’ai regretté, oui... M’enfin, ça s’est passé ailleurs aussi, ça a été la libération partout. Dans la Sarthe, j’ai vu arriver les Américains alors que les Allemands étaient encore là. C’était pas drôle non plus parce qu’il y avait des bombardements sur une gare tout près de chez nous, qui servait de réserve d’explosifs allemands. Les Anglais le savaient par les renseignements, ça fait que tous les soirs à sept heures on voyait passer les avions qui venaient bombarder la gare - on les appelait les « deux queues ». Nous, on n’habitait qu’à trois kilomètres de là : vous savez, pour un avion, à trois kilomètres près, on peut se tromper. Alors on allait aux abris, il y avait des tranchées dans les champs. Parfois ils n’atteignaient pas leur cible, les bombes tombaient à côté mais enfin, elles tombaient quand même ! Et un soir on a eu l’ordre de sortir de chez nous. On a attendu toute la nuit dans le chemin et jusqu’au soir du lendemain, mais il y a rien eu du tout, on est rentré. Mon mari (il était bricoleur !) avec une boite d’Ovomaltine il avait tombé des fils, il avait fait un poste de radio - parce qu’on n’avait plus de radio, ils coupaient l’électricité. Et le lendemain, c’est lui qui a donné l’alerte. En se réveillant il a écouté les nouvelles et alors il a dit : « Tiens, c’est le débarquement ». Il était six heures du matin, c’était le débarquement ! Alors on se lève, on sort et sur la voie de chemin de fer, une petite voie régionale, qu’est ce qu’on voit ? Une grosse locomotive. Je dis à mon mari « Viens voir ! Qu’est-ce que c’est que ça ? ». C’était une pièce de marine. Et juste après, on voit des Allemands qui viennent à la gare, et puis de l’autre côté on voit arriver les Américains, ils étaient pas nombreux, juste un petit camion. Tout le monde était sorti, on savait que les Américains allaient arriver - mais par où ? On s’était dit « bon bah on va attendre », mais quand on a vu que les Allemands étaient toujours là, comment qu’on est rentrés chez nous ! Ils étaient pas nombreux, les Américains, mais ils ont rattrapé les Allemands, ils les ont mitraillé près du cimetière, il y en a un qui est mort. C’est l’institutrice qui les a reçus après, elle leur a souhaité la bienvenue en anglais. Quand ils sont arrivés en 1944 ça a été une folie, tout le monde les recevait, il n’y avait pas de maison où ils n’allaient pas. Il y avait bal deux fois par semaine, on allait danser. Et vous savez, ils étaient organisés. Il y avait une rivière pas très loin alors on a été les voir : ils se baignaient, ils avaient installé des douches, un terrain d’aviation, les avions atterrissaient là. Ce qu’ils voulaient c’était de l’alcool, des tomates et des œufs. Alors on apportait tout ça et eux ils nous donnaient du sucre, des confitures, du café en poudre, c’était formidable. Bernard était petit à l’époque, il était un peu rouquin alors ils l’appelaient « baby cheveux rouges ». Il y en avait un qui le prenait et qui le trimballait dans le camp, c’était comme ça. Ils sont restés là deux mois. Ça a été une bouffée d’air, parce que quand même, avec les Allemands pendant quatre ans, on était étouffés. Les Allemands visitaient les maisons, y en a qui sont venus un jour où j’étais toute seule avec mon fils. Ils cherchaient à se loger, ils ont bien vu qu’on n’avait que deux pièces. Ils m’ont demandé de faire une omelette et puis ils sont partis. C’était comme ça, ils rentraient dans les maisons... Là c’était pas assez grand, mais un dimanche on était chez une dame amie de mes cousins, c’était une ferme, on était là en train de discuter. Ils sont rentrés : « Bonjour » (ils étaient quand même polis), ils ont vu qu’il y avait des chambres, eh bien ils se sont installés. Ils venaient à deux ou trois mais après c’était tout le groupe qui arrivait. Ceux-là, ça allait, mais les endroits où les SS se trouvaient, c’était dangereux. Ils cherchaient des femmes surtout. Et à manger. Une fois on a eu peur parce qu’il y en avait qui logeaient dans le café, ils avaient été faire une virée et ils avaient ramené une poule. Ils ont demandé à la propriétaire du café de la faire cuire mais cette poule, elle avait quel âge ? Elle voulait pas cuire ! C’est une poule qui traînait, alors vous pensez bien que c’était pas du chapon. Mais ils avaient faim, ils voulaient manger la poule et ils pensaient qu’elle était de mauvaise foi, la dame. Ils ont failli la tuer.
Dans la vie il y a des choses comme ça, c’est pas des bons souvenirs. Mais après tout revient petit à petit à la normale, sans qu’on s’en aperçoive la vie reprend ses droits. (Tic tac de la pendule).
Vous vous souvenez de la première fois où vous avez pu voter ?
En 1946... Non, je ne me rappelle pas... Non.
Et mai 1968 ?
Oh mai 1968, là c’était autre chose. Pour ce qu’il en reste... Il y a eu un peu de libération, mais franchement, c’était concentré à l’Odéon. J’avais soixante ans, ce n’était pas ma génération. J’allais au Luxembourg tous les jours promener mon premier petit-fils qui était bébé, mais je n’ai absolument rien vu et pourtant l’Odéon est là, tout près ! Quand j’allais à la campagne les gens me disaient : « Ah ! Comment ça se passe ? ». On aurait dit que c’était la révolution. Je répondais : « Il ne se passe rien, c’est tout à fait concentré au même endroit ». L’Odéon et Saint Michel, le Quartier Latin.
Vous compreniez que les jeunes veuillent changer le monde ?
« Changer le monde »... c’est difficile de changer le monde ! Et c’est bien prétentieux parce que finalement, à part Cohn-Bendit qui est au Parlement Européen, les autres on ne sait pas ce qu’ils sont devenus. Ils se sont casés certainement dans les journaux, la politique, mais ils n’ont rien fait. Je crois surtout qu’ils se sont amusés.
Quand on arrive à un âge aussi avancé que le vôtre, on perd beaucoup de monde en route, vous avez eu beaucoup de deuils.
Ah oui... oui. Quand j’ai perdu mon mari, ça a été un mauvais moment... Il était malade mais il ne disait rien, il ne se plaignait jamais, jamais. Et puis un jour, on était en voiture avec ma belle-fille et il est mort dans la voiture. Il est mort à la tour Montparnasse. Ah ça ! Il a été exaucé parce qu’il disait toujours : «Moi j’aimerais passer comme une lettre à la poste». C’est exactement ce qui s’est passé. C’était en soixante-quinze, j’ai mis du temps à m’en remettre. (Tic tac de la pendule). Aujourd’hui mes oncles et tantes, mes cousines, ils sont tous disparus. Ça se comprend, à cent quatre ans. Mais je ne sais pas... Pourquoi moi ? Quand je vais chez le médecin, il est étonné. Il me regarde comme ça, d’un air... Je suis arrivée à cet âge sans m’en apercevoir. Le temps est passé très vite, je ne me suis jamais ennuyée. C’est peut-être aussi une question de caractère, je ne sais pas, ça dépend comment on prend la vie...
Vous la prenez comment, la vie ?
Je la prends comme elle est. Il faut pas lui demander de trop, il faut prendre ce qu’elle vous donne. Il faut faire un effort, mais il faut pas vouloir dominer le monde quand on ne peut pas. On est heureux quand même.
Ça va, pas trop fatiguée d’avoir tant parlé ?
Oh non.
Vous n’avez pas mangé votre gâteau...
Oui ben voyez : toute brebis qui bêle perd la goulée.
[1] Carl-Heinrich von Stüpnagel, général d’infanterie de la Wehrmacht, exécuté par les nazis le 30 août 1944 pour avoir participé à l’attentat de juillet 1944 contre Hitler.