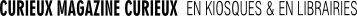


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)



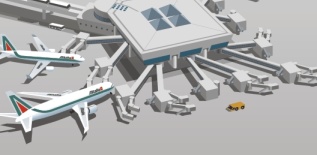 |
|
|
Publié dans le
numéro IX (mai-juin 2008)
|
Le voyage débute dans le RER B, sur cette ligne objet d’un autre voyage, celui de François Maspéro en 1989 dans Les Passagers du Roissy-Express (Points-Seuil). Dans le RER, un petit panneau m’indique qu’il y a deux « gares » à l’Aéroport Charles-de-Gaulle, gares reliées par un VAL, métro automatique fonctionnant 24 heures sur 24. L’utilisation un rien désuète du mot gare, en souvenir je l’imagine d’aérogare, me réjouit. Je finirai bien plus tard par comprendre qu’il s’agit en fait de gares RER, et non d’aérogares : de nos jours, on dit un terminal. Dans le RER, je note que la voix féminine qui annonce dans le haut-paleur le nom de la station le fait d’une manière très précise : d’abord avec une voix montante (espoir, il va se passer quelque chose), puis avec une voix descendante (bon, maintenant, préparez-vous à descendre). Préparez-vous à descendre : votre voyage commence.

La signalétique. Penser que dans le monde entier des gens travaillent, en échange de salaires conséquents, sur la meilleure façon d’indiquer où l’on se trouve et où l’on va. Je suis descendu au premier arrêt du RER, qui indique Terminal 1 et Terminal 3. Je vois bien où je peux aller (d’un côté le T3, de l’autre le T1), mais je ne comprends pas du tout où je suis. Dans une espèce de no man’s land (quelques guichets pour prendre un billet vers Paris-Centre et un marchand de journaux fermé). Je finis par comprendre, grâce à une dizaine de panneaux disposés autour d’un pilier portant le nom pompeux d’ « exposition », que je suis dans le Roissypôle. Comme le dit le texte, « la gare RER de Roissypôle a 30 ans. Ses équipements d’origine ne sont plus adaptés aux besoins ». C’est le moins qu’on puisse dire. Plus tard je serai frappé par la hiérarchie architecturale de Roissy, à la fois temporelle (plus c’est récent, plus c’est beau) et structurelle (RER moche, moyens courriers pas mal, longs courrier sublime). Un panneau présente le CDGVAL : « Du terminal 1 au terminal 2. Aujourd’hui 25 minutes en bus. À l’été 2006, 8 min en CDGVAL. » Cette grandiose exposition est donc là depuis plus de deux ans. Au vu du trafic de l’aéroport (près de 60 millions de voyageurs par an), on peut en déduire que c’est l’exposition qui a eu le plus de visiteurs en France.
Un bruit résonne dans le hall. Non pas un avion comme on pourrait bêtement le penser. C’est simplement parce qu’un RER vient de déverser des flots de voyageurs, tous équipés de valises à roulettes. Le sol étant fait de petits graviers agglomérés dans du béton, cela vibre de façon éprouvante. Juste devant moi, une énorme affiche Novotel me cligne du N. Je jette un coup d’œil aux tarifs ; 130 euros la nuit, tout de même. Avant de quitter Roissypôle, je fais le tour des bâtiments extérieurs : le Dôme, l’Aéronef, autant de noms hautement poétiques qui ne sont en réalité que des immeubles de bureaux, entièrement vides en ce samedi après-midi. À l’intérieur, je profite encore un peu du mouvement que chaque nouveau RER génère. Je sais que là-bas, dans les terminaux, il y aura plein de gens comme moi, assis, à attendre. Parce qu’ils ont bêtement respecté la consigne de leur billet imprimé qui leur enjoint de se présenter deux heures avant le décollage. On a beau savoir que c’est exagéré, quand on voyage peu, on n’ose pas déroger. Ah tiens, un avion, enfin, qui décolle.
Direction le Terminal 3. C’est le seul que je connaisse un peu. Logique : c’est le terminal des pauvres, celui des vols charters et des compagnies low-cost. J’ai toujours adoré la façon d’y aller, un fléchage hystérique, répété tous les deux mètres, avec l’indication du temps restant à parcourir. Le petit toit anti-pluie tout au long du chemin ne parvient pas à masquer le peu d’intérêt qu’Aéroports de Paris porte aux clients qui investissent si peu dans leurs billets d’avion. Dans le petit tunnel creusé sous l’autoroute, des panneaux indiquent « contrôlé par vidéo-surveillance ». Même sur ce point, ils se moquent de nous. Pour y être passé une dizaine de fois au cours de ces quelques heures, je suis formel : il n’y a pas de caméra.
Le terminal 3, d’un point de vue architectural, c’est : quatre tôles sur les côtés pour les murs, et une tôle en haut pour le toit. J’ai vu des grandes surfaces de bricolage mieux pensées. Je m’apprête à repartir, quand soudain, je le vois. Lui, l’habitant de l’aéroport. Le clochard céleste - au sens où, voisin des avions, il est plus près du ciel. Un jeune homme noir habillé d’une veste marron qui ressemble à la mienne, poussant un chariot débordant de sacs. Quand je l’aperçois, il regarde dans une poubelle pour apprécier la qualité d’un sac de brioche qu’un voyageur vient de jeter. Il fait un tour lent du T3 avant d’aller s’asseoir près des toilettes et de débuter un lent examen de ses victuailles.
Je prends le VAL pour rejoindre le T1. Son numéro d’ordre, tout autant que son architecture, indique que c’est le premier terminal ici construit. De vagues réminiscences de mon enfance remontent à la surface devant cet immense rond dont on se demande si on parviendra un jour à en faire le tour (ou si on l’a déjà fait sans s’en être rendu compte). Dans le cercle central, des escalators diamétraux montent vers les portes d’embarquement. Combien de films des années 1970 et 1980 se terminent ici, dans ces croisements hautement cinématographiques vers un ailleurs qu’on ne peut que soupçonner. J’aime beaucoup cette architecture déjà un peu démodée mais qui garde de son époque cet optimisme très Trente-Glorieuses. Le sous-sol accueille des petits commerces : une poste, et un MacDo qui doit être celui qui ferme le plus tôt de toute la France (22 heures). Dans un kiosque à journaux, je lis, debout, le livre de Philippe Ridet, Le Président et moi. Je tombe sur la passage où le journaliste du Monde raconte les voyages à l’étranger avec Sarkozy, l’arrivée à « Roissy 1, porte 4 ». Je lève les yeux : je suis juste à côté. En arrivant devant le T1, j’ai vu les deux Airbus aux couleurs de la République française. Ridet raconte le salon VIP, le champagne qu’on sert aux journalistes avant d’embarquer, les vins fins pendant le vol. Et il a cette phrase drôle sur le décollage sans la moindre angoisse : « a-t-on déjà vu un avion présidentiel s’écraser ? ».
Après un après-midi gris et crachotant, le ciel s’est soudain éclairci. Il est 19 heures et le soleil est lumineux. J’ai presque l’impression qu’on est le lendemain matin, toutes les références temporelles ayant tendance à s’évanouir ici. Sur la route qui mène du VAL au Terminal 2F, une série d’immenses pots de fleur remplis de cailloux de couleurs différents sont alignés sur des dizaines de lignes. Personne ne les regarde ; personne sauf moi, qui ait le temps de flâner. Du F on rejoint le E par le sous-sol, ce fameux 2E avec ses murs et son toit en bois, et sa voûte grandiloquente - un peu trop ambitieuse : c’est elle qui s’était effondrée, au printemps 2004. Ici, c’est le royaume d’Air France. Cela devient même haut de gamme avec l’espace « Première Enregistrement ». Qui est dans une petite salle close et basse de plafond. Qui propose des canapés en cuir pour patienter. Qui a un peu de moquette devant chaque comptoir d’embarquement. Ne manque plus qu’un chariot aux roues de cristal.
Sur le siège où je prends mes notes, je trouve une feuille abandonnée : « En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 dias del mes de marzo de 2088 recibí del Señor Ignacio Rojo la cantidad de Pesos Nueve Mil Seiscientos ($9.600.-) por cancelación de prestación acordada, no teniendo más nada que reclamar por la operación comercial realizada referente a la inspección de producto agrícola realizada en conjunto ». C’est tout de même plus classieux que les vieux numéros de 20 minutes qu’on trouve sur les quais des métros parisiens.
Au bout des 2E et 2F qui sont en vis-à-vis, il y a la gare SNCF. C’est presque décevant : les bornes d’achats de billets de la SNCF et les composteurs jaunes font mauvais genre, un peu comme un cousin de province qu’on est bien obligé de convier à son mariage. Le plus étonnant, c’est que juste au-dessus de la gare, il y un hôtel Sheraton. Je m’arrête devant le hall, subtilement chic alors que si on tourne la tête d’un quart on voit les tristes escalators de la SNCF. 539 euros la chambre, il y a des gens prêts à tout pour dormir au-dessus d’une gare.
J’enchaîne sur la série interminable 2C, 2A, 2B, 2D, tous les quatre plus ou moins identiques. Après tous ces kilomètres parcourus, un peu comme dans une ville au bout de quelques heures de marche, j’ai le sentiment de comprendre les interactions géographiques, la façon dont l’espace est disposé, comment les liaisons s’imbriquent, comment les réseaux (fer, val, avions) interagissent. C’est mon aéroport, maintenant. Je suis chez moi. Ça tombe bien, c’est l’heure du dîner.
Une heure plus tard, je dois bien me résoudre à l’admettre : les sièges massants sont invisibles, certainement relégués dans les zones d’embarquement (pour éviter les squatteurs de mon genre). Seule lueur d’optimisme : alors que les fauteuils sont partout en métal, au sein du 2F ils sont légèrement rembourrés. Il est 22h30. L’aéroport est presque vide, déjà. Je croise mes futurs voisins de nuit : un italien mal rasé à qui je donne 40 centimes d’euros pour un café. Et quelques clochards réellement barbus, l’un avec des béquilles, déjà installés sur les fauteuils « confortables » du 2F. Il fait chaud, et il ne viendrait à l’idée d’aucun policier d’embêter des silhouettes endormies sur un fauteuil. J’observe différentes stratégies de contournement des accoudoirs. Dormir en diagonale par tiers. Se poser sur ses bagages quand on en a. Le lendemain matin, je verrai même deux hommes avec un petit matelas. La plupart des dormeurs se couvrent la tête : on y voit dans cet aérogare comme en plein jour. Le Grenelle de l’environnement ne semble pas être arrivé jusqu’ici.
Je repars vers le T3, en imaginant que les charters embarquent plus facilement à n’importe quelle heure de la nuit, mais, malgré une amplitude plus large (dernier vol à 01h50, premier à 05h20), les vols cessent pendant la nuit. Quelques SDF sont endormis. Le T3 est le seul terminal où il y a des fauteuils contigus, sans des accoudoirs qui empêchent de s’allonger.
Dans la partie Arrivées du T3, il reste beaucoup de monde. Manifestement, des gens qui attendent des amis ou de la famille. Le fait de n’être dans aucun de ces rythmes, départs, arrivées, donne à ce moment une teinte agréable. Moi qui ne supporte pas d’attendre, je me laisse porter par la torpeur générale. Je fais à nouveau le touriste : devant le local des douanes, un procès-verbal est affiché. Deux agents ont, si j’ai bien compris leur langage technique bizarre, saisi des médicaments qu’un certain Jin Guoncheng, citoyen chinois résidant à Palerme (passeport chinois n°147298671, valable jusqu’au 13/06/2010), avait laissé en consigne. Or l’acte « n’a pas été donné à monsieur Guoncheng, absent. Il n’a pas pu non plus le signer. Copie n’a pas pu lui être remise. Une copie est immédiatement afffichée sur la porte n°AH235 de la brigade ».
Non loin du T3, je rentre dans le hall de l’hôtel Ibis, petit havre de paix hormis le fait qu’il sente fortement la soupe aux légumes. 99 euros la chambre. Un groupe de japonais écoute les conseils d’une guide, qui répète « zéro zéro zéro zéro » à plusieurs reprises, sans que je sache s’il s’agit de français ou de japonais. Il y a un café, qui ne ferme qu’à 2 heures. Et à 4 heures, une salle de petit déjeuner prend le relais. À Roissy, on peut donc boire un café 22 heures sur 24. Je m’assieds dans un vrai fauteuil et m’assoupis, gardant le journal ouvert sur mes genoux, afin de donner le change.
Ce soir-là, j’ai vu des milliers d’histoires passer devant soi. Des milliers de personnes qui, chacune à leur manière, racontent l’état du monde. Certainement plus que dans le journal posé sur mes genoux, la banderole raciste du PSG, les mesures d’économie de Sarkozy, la flamme olympique à Londres. Chacun des gens qui passent par ici, des classes moyennes inférieures du T3 aux riches du Sheraton, chacun d’entre eux : m’intéresse. Mais pas quelques phrases et puis s’en va. M’intéresse comme un ethnologue. Regarder des valises rouler devant soi, déjà c’est passionnant. Alors le contenu, je n’en parle pas. (Et ces lignes tracées dans le fauteuil jaune, entre deux moments de sommeil, je les garde, malgré leur naïveté nocturne). Ensuite, ce sera le retour à routine : le lendemain matin, dès cinq heures, l’aéroport redevient un lieu de voyages. Les écrans annoncent des vols toutes les cinq minutes. Pékin, Berlin, Amsterdam, Papeete, trop de voyages tuent le voyage. La foule se presse. Moi j’ai fini ma visite. Il est temps de rentrer. Je suis complètement jet-laggé.
............................................................................
HISTOIRE DE ROISSY
C’est en 1964 qu’est décidé la création d’un aéroport au nord de Paris, pour suppléer aux faiblesses des deux aéroports parisiens existant, Orly et Le Bourget. Dix ans plus tard, en 1974, le Terminal 1, conçu par l’architecte Paul Andreu (salarié d’Aéroports de Paris) sur le modèle de la pieuvre, ouvre ses portes au public. Depuis 2004, il est en cours de rénovation, accueillant encore 20% du trafic total de l’aéroport. En 1982, les terminaux 2A et 2B ouvrent à leur tour, suivis du 2D (1989), 2C (1993), 2F (1999) et 2E (2003). C’est une jetée d’embarquement de ce dernier qui s’est effondrée le 23 mai 2004, causant la mort de 4 personnes. Ce n’est qu’en 2008 que cette partie du 2E a rouvert.
Entre-temps, en 1991, le T9 (pour « neuf »), rebaptisé T3, a été ouvert pour accueillir les charters. Les services y sont réduits, ce qui permet des taxes aéroportuaires moindres. Et en 1994, une gare SNCF a été créée, entre les terminaux 2E et 2F.