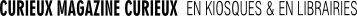


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


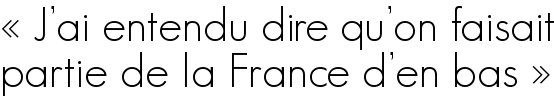
 |
|
|
Publié dans le
numéro 018 (Juin 2012)
|
Entretien (deuxième partie), avec Yvonne C., 104 ans. Propos recueillis par Emilie Giaime et Thibault Camus.
L’après-midi du 16 avril 2012, nous retrouvons Yvonne C. chez elle, dans l’appartement de deux-pièces où elle vit depuis 1939, rue du Cherche-Midi à Paris. On feuillette un petit carnet qui porte sur la couverture la date « 1975 » inscrite au stylo bille. Dans le tiroir ouvert du bahut, plusieurs carnets d’un format à peu près identique dans lesquels, depuis les années 1970, Yvonne C. consigne méticuleusement toutes ses dépenses. Parmi les plus importantes, le fauteuil sur lequel je suis assise, structure en bois recouverte d’une toile rayée, qu’elle se rappelle avoir payé à peu près 1300 francs et dont nous cherchons à retrouver l’année d’achat.
1300 francs... Je cherche. Je cherche... Ah ! « Fauteuil...
Ah !
... 1370 francs »
J’ai quand même un peu de mémoire... Quelle année ?
1978. Novembre. Ça fait trente-quatre ans.
Ah ben c’est pour ça qu’il est un peu dur ! Et puis alors les accoudoirs sont partout raccommodés.
Gros mois d’ailleurs, parce que ça a plombé ton budget. C’est ta plus grosse dépense de l’année, plus que le loyer.
Enfin moi c’est spécial mon loyer, parce que je suis sous la loi de 1948. Alors ça ne marche plus, ça, ça s’éteint avec les personnes. L’augmentation est la même chaque année - oh ça a été 4% à un moment donné, mais sinon c’est 2%, chaque année, c’est décidé. Mais on n’en parle plus de la loi de 1948, on n’en parle plus. (Silence). Vous voulez une petite chouquette ?
[Elle va dans la cuisine chercher un petit sac en papier blanc plein de viennoiseries.]
Vous savez qui a fait cette loi ?
La loi de 1948, ça a été voté... Oh je ne sais plus ! Les lois, tout ça, je ne sais plus moi. Mais ça a été un avantage pour les gens comme nous. Après il a été voté qu’elle disparaissait quand le gens mourraient - si je meurs, c’est fini, quand je m’en irai ici ce sera terminé.
Sauf si quelqu’un se domicilie chez vous.
Oh oui mais ça se passera pas comme ça. Heureusement, le propriétaire d’ici n’a jamais voulu vendre parce qu’il a trois petites-filles et qu’elles viendront peut-être un jour faire leurs études à Paris. (Silence) Ça fait que je suis tranquille. Seulement ils ne font aucune réparation. J’ai des fenêtres qui auraient besoin d’être changées... Celle de la cuisine, je ne risque pas de m’asphyxier puisqu’elle ne ferme pas ! Si ça se trouve ce sont des fenêtres qui datent de la construction de l’immeuble.
Il date de quand, cet immeuble ?
Oh... Le devant, ça date des mousquetaire, du XVè siècle : il y avait des mousquetaires, c’était les chevaux du roi ici. C’est pour ça qu’il y a des pavés et un porche à l’entrée. C’était que des chambres.
Des chambres de mousquetaires !
Voilà. Après il y a eu l’immeuble du milieu, trois étages... Disons deux étages et des chambres sous les toits. Et puis après ici [tout au fond de la cour]. Ici, c’était moderne pour l’époque. D’après ce qu’on ma dit, mon immeuble daterait de 1870. Alors il y a quand même deux pièces dans mon appartement, et ça devait être général parce que chez mon beau-père, rue de Bucy, c’était exactement la même disposition. Et il y a deux waters par étage, alors que l’immeuble de devant, il y a un seul water pour cinq étages.
Les gens en ont fait installer chez eux, des toilettes. Maintenant dans l’immeuble il n’y a plus que vous qui n’en avez pas dans votre appartement.
Ben oui parce que les propriétaires ne l’ont pas fait. Chez moi, il n’y a eu aucun travaux. Mais je suis favorisée quand même, parce que je ne pourrais pas rester autrement. Alors je serais où ? Je ne sais pas.
Là, si ce n’est pas indiscret, vous payez combien de loyer ?
Ça me fait quatre-cent soixante quinze euros par trimestre, si on compte les cent euros de charges.
A peu près 125 euros par mois de loyer sans les charges... C’est pas beaucoup.
Ben ça tombe bien ! Parce que je vis quand même depuis trente-six ans avec la demi retraite de mon mari, parce que moi personnellement je n’ai que quatre-vingt-dix-sept euros tous les trois mois.
De votre retraite à vous ?
Non ce n’est pas une retraite, c’est une complémentaire. Je n’avais pas droit à une retraite mais j’avais quand même droit à une complémentaire pour le temps où j’ai travaillé dans la coiffure, de... Attendez voir... Oui : de 1924 jusqu’en 1932.
Pour huit ans de travail, vous avez 97 euros tous les trois mois... Et la demi retraite de votre mari qui était électricien à l’Opéra de Paris.
Oui, c’est la législation pour tout le monde. Et celles qui n’ont rien, je sais pas comment elles font.
Vous nous avez dit que quand vous avez emménagé ici avec votre mari, en un mois de salaire vous aviez de quoi payer un an de loyer.
Oui ! Quand on est entrés dans l’immeuble, au rez-de-chaussée d’abord - ça fait 82 ans maintenant - on payait 1800 francs de loyer par an, avec les francs de l’époque. Avant qu’il travaille à l’Opéra, mon mari gagnait 800 francs par mois chez Saunié-Duval, moi des fois j’avais 1000 francs en travaillant comme coiffeuse... 1100, 1200 francs si mes clientes à cent francs de pourboire venaient.
Vous gagniez plus que votre mari !
Oui mais c’était pas régulier, moi. J’avais des clientes qui me donnaient 50 centimes de pourboire, ou parfois rien. Mais on vivait comme des pachas.
Pourtant vous n’avez jamais été trop dépensière, si ?
Oh on ne comptait pas ! On voulait aller quelque part, mon mari prenait sa journée. Il n’était pas payé mais ça ne nous gênait pas, on partait. Une fois on est allé au Havre, on voulait voir le paquebot le Liberté. C’était un lundi - parce que moi je ne travaillais pas le lundi du fait qu’on travaillait le dimanche au salon de coiffure, il y avait la semaine anglaise déjà à l’époque. Mon mari a pris sa journée, on est allé au Havre, on a vu le Liberté mais on n’a pas pu le visiter parce que les visites étaient réservées aux groupes, et nous on n’était que tous les deux. Mais on l’a vu. Puis on est revenus. Et quelques temps après on va au cinéma rue de Rennes et là qu’est-ce qu’on voit ? Le Liberté ! On a vu toute l’installation, tout l’intérieur dans le film.
Il allait où ce bateau ?
Eh bien en Amérique. C’était un paquebot tout neuf...
Vous auriez voulu le prendre, vous ?
Non. Non.
C’était vers quelle année ?
Dans les années 1930 et quelques. On est allé à Trouville aussi, parce que mon mari avait travaillé là-bas. Eh bien c’est pareil, il a pris sa journée et on y est allé. (Silence) On vivait bien, on vivait bien. Et puis on n’était pas exigeant : y avait rien, on pouvait rien acheter. Tout ce qui existe maintenant, ça n’existait pas. Et on vivait dans la cité, les voyages n’existaient pas encore parce que l’aviation civile commençait seulement à évoluer. L’aviation civile c’était Mermoz et Saint-Exupéry, c’était nos héros...
... Et Latécoère.
Oui ! Latécoère à Toulouse.
Vous, vous n’avez jamais pris l’avion ?
Non, jamais. Voyez : je mourrai avant d’avoir pris l’avion.
Vous n’avez jamais eu envie de prendre un billet d’avion pour voir ce que c’est ?
Pour aller où ?
Je sais pas... En Inde. Au Pérou. A New-York ?
Oh tiens et qu’est-ce que je ferais à New-York ? [rires] Non, l’Amérique ne fait plus rêver maintenant. Mais elle a fait rêver, l’Amérique : je me rappelle lorsque je travaillais rue de Bucy j’avais une cliente qui me racontait que les femmes de ménage là-bas allaient travailler en voiture... Alors en 1930, c’était extraordinaire d’entendre ça chez nous ! C’est comme la première fois qu’une jeune fille m’a dit « Oh ben vous savez, ma tante a acheté un appartement ». On était en 1931, moi je ne savais même pas qu’on pouvait acheter un appartement.
Vous auriez aimé voyager ?
Oui j’aurais aimé voyager et j’en ai souffert, quand je voyais les gens partir une fois qu’il y a eu les congés payés. Il y a des gens qui sont partis, mais nous on ne pouvait pas. J’en ai souffert et puis ça m’a passé parce que ma destinée était autre, tout simplement.
Pendant les premiers congés payés, les gens partaient où ?
Le plus souvent ils restaient en France. En 1938, les premiers congés payés c’était une belle conquête. Et c’est tout ce qui reste du Front Populaire - peut-être qu’un jour ça s’arrêtera.
Vous croyez ?
Oh ! Avec les politiques ? Ils sont capables de tout. Et comme les gens ne réagissent pas... Parce que vous, vous avez tout. Nous il y avait tellement de choses que nous n’avions pas, quand on pense comment on a débuté... Vous, vous ne voudriez pas vivre comme cela. On avait un toit, c’est tout. Mais on vivait, on était gais, on sortait, on allait au théâtre, au cinéma. Enfin l’un dans l’autre, la France, c’est un pays de cocagne, on devrait vivre heureux comme tout parce qu’on a tout... Mais ils ont tout anéanti. On mange mal, les légumes n’ont aucun goût. Et les cochons ! Quand j’étais enfant, on avait des cochons à la ferme, chez mon oncle dans la Sarthe, ils étaient nourris avec des pommes de terre. Tous les jours on faisait la « chaudronnée » : dans une grande marmite en fonte, on faisait cuire les pommes de terre qu’on écrasait avec du lait, du son et des feuilles d’ormeaux. Ils se régalaient ! Et la chair était bonne. Bah oui maintenant vous ne savez plus si vous mangez du porc, la nourriture n’a aucun goût. Pourquoi ? Parce qu’on a voulu la surproduction. Mais ce qui est en surplus, on le jette. Alors c’est du gâchis ! Et ce qui est en surplus, on le paie quand même. Et qu’est-ce qui a fait ça ? C’est Bruxelles.
Vous êtes contre l’Europe ?
L’Europe, c’est une très belle idée mais ils l’ont gâchée. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a que des incapables. Moi y’a longtemps que je dis qu’il faut fiche une bombe là-dessus !
Vous êtes une terroriste, Yvonne !
Voilà ! L’Europe, ça date d’après la Libération. Quand j’ai eu cent ans, ma voisine Mme B. m’a dit « Vous achetez le livre que vous voulez », parce qu’elle avait fait une randonnée dans l’immeuble et les gens ont donné de l’argent - je ne sais pas combien parce que c’est elle qui a fait les comptes. Alors on est allées à la Fnac et j’ai choisi ce livre, Jean Monnet, Les Pères de l’Europe, que j’ai mis un an à lire - ça fait neuf cents pages. C’est passionnant, les débuts de l’Europe, c’est formidable.
Et qu’est-ce que ça vous a fait, le rapprochement franco-allemand au moment de l’UE ?
Y avait pas le choix.
Vous ne faisiez pas partie des gens qui ne voulaient plus entendre parler des Allemands.
Ecoutez, on avait déjà payé la première fois, pour la première guerre. Nous avions un président, M. Poincaré, qui était lorrain. Et quand ce couple a été assassiné [attentat de Sarajevo] soi-disant par un Serbe, ils ont pris ce prétexte pour déclarer la guerre. Mais je crois qu’ils auraient pu éviter ça. Et peut-être que Poincaré a pensé qu’il pourrait récupérer sa province... Enfin je ne sais pas. En tout cas la guerre a eu lieu et après il a fallu de nouveau remonter la France. Et les Allemands ont eu des dommages de guerre à payer, ils ont eu l’occupation par la France, par les Anglais, par les Russes et par les Américains. Ils ont eu ce que nous on a eu quand ils nous ont occupés, pendant la deuxième guerre. Les politiques le savaient, ça, mais ils les ont poussés à bout. Et quand Hitler est arrivé, il leur a promis ce qu’on nous a promis là, ce que Sarkozy a promis à un tas de gens et qu’il n’a pas tenu.
Vous ne les aimez pas beaucoup, les politiques.
Non.
Et de tous ceux que vous avez vus en exercice sous les IIIème, IVème et Vème Républiques, il y en a que vous avez plus appréciés ?
Oh ben De Gaulle - même si ce n’était pas un politique, c’était un militaire. Il a rétabli quand même la République. Il n’a pas profité, il vivait normalement.
Il a pourtant été très autoritaire, à la fin.
Oui parce que c’est pas rien de faire une décolonisation. C’est pas drôle d’avoir le pouvoir, parfois.
Vos deux fils ont fait la guerre d’Algérie ?
Oui. Mais vous savez, ceux qui l’ont fait n’en parlent pas. Il s’est passé des choses... C’est pareil, là : on était chez eux. L’histoire de la guerre d’Algérie, je l’aie là (elle montre du doigt le bahut) : c’est un pavé que mon fils Bernard m’avait offert. J’en ai lu une partie mais c’est pas du roman, hein ! Alors je m’y remettrai.
Ils sont partis en quelle année, vos fils ?
Michel est parti en 1955, tout au début. Il était à Alger, lui, il était dans le Djebel. Il y est resté vingt-cinq mois. C’est long. Il est revenu une fois. (Silence) Plus tard je lui ai rendu ses lettres. Je les avais relues... J’aurais pas dû : ça m’a fichu le cafard. Parce qu’il avait un cafard fou (Tic tac de le pendule). Mais tous ceux qui sont revenus n’en ont jamais parlé.
Il ne vous a jamais raconté ce qu’il avait vécu là-bas ?
Jamais. Jamais. Dans ses lettres non plus, mais je sentais qu’il y avait quelque chose qui clochait. On aurait pu le faire revenir, parce qu’il y avait eu un camarades aux Arts appliqués, son père pouvait le faire revenir. Et puis on connaissait aussi Mme L. qui travaillait au deuxième bureau militaire - son mari M. L. allait souvent à l’Opéra voir les spectacles et il avait dit à mon mari : « J’ai demandé à ma femme, on peut le faire revenir ». Et en effet, ça a marché mais le capitaine de Michel lui a dit : « Ecoutez C., vous pouvez partir. Mais vous pourrez aussi être rappelé et si c’est le cas, vous ne serez peut-être pas ici, ça pourra être pire ». Alors il est resté là-bas. Et Bernard, mon deuxième fils, était à Oran. Il y a été moins longtemps lui, un an, c’était la fin. Mais c’est pareil, il n’en parle jamais - déjà, il parle pas beaucoup. Mais même ici, il y a eu une période où c’était... C’était sale, c’était une sale période, la guerre d’Algérie. Parce qu’on a dit « ils ont commencé » mais c’est toujours pareil : on ne veut pas céder. Et je me dis : « à quoi ça sert, la diplomatie ? » La diplomatie, c’est fait pour discuter parce que les gens ne sont pas d’accord. C’est normal qu’on ne soit pas d’accord, ça serait monotone, hein ? Eh bien c’est fait pour ça, la diplomatie. Mais on ne veut pas céder, et on paye des diplomates qui ne font rien. On a dit que la France était grande... Oui, mais sur le dos des autres, parce qu’on en a tiré quand même des avantages. Alors nous, sur le moment, ce qu’on voulait c’était que ça se termine et que nos enfants reviennent. Et puis les Français sont assez arrogants : les Algériens c’était les « Fellagas » et... Comment qu’on les appelait aussi ? Oui, « les Bougnoules ». Ecoutez ça ne fait pas plaisir quand même, « les Bougnoules » ! On est comme ça en France, on se croit supérieurs. Mais non. Et on est bien traités aussi par nos dirigeants : j’avais entendu dire qu’on faisait partie de « la France d’en bas ». Nous n’avons pas oublié ces choses là, moi c’est ça qui me tient debout. « La France d’en bas »... Quelle humiliation. Et qu’est-ce qu’ils sont, eux ? La France d’en haut ? Parce qu’ils sont allés à l’école et que les autres n’y sont pas allés ?
Parce qu’ils ont le pouvoir ?
Mais nous aussi, par le groupe qu’on forme, on a un pouvoir. Ils nous promettent la lune mais ils ne disent pas la vérité, il ne faut pas les croire. Ils trompent pour avoir nos voix.
Vous, vous allez aller voter ?
Si je peux marcher... Oui, j’irai au bureau de vote, mais c’est pareil : y a plus de bancs sur le trajet ! Avant on pouvait s’asseoir mais maintenant, Boulevard Raspail, ils ont enlevé les bancs, je ne sais pas pourquoi. Il en reste un mais on est déjà arrivé au bureau de vote. De toute façon j’irai voter au deuxième tour : je veux foutre Sarkozy à la porte, rien que pour ça j’irai. Même si je mets une heure pour aller au bureau de vote, j’irai. « Travailler plus pour gagner plus » : et le chômage ? Y a plus de boulot, plus d’usine, plus rien. Alors ? Le travail, c’est ce qui nous fait vivre, c’est la liberté. Même si vous gagnez peu, vous le gagnez honnêtement, vous vivez de ce que vous gagnez. Le peuple doit avoir une certaine dignité. Les politiques veulent la place, on la leur donne, et bien qu’ils travaillent. On les paye, c’est normal, mais ils doivent être nos serviteurs.
On parlait tout à l’heure de l’Amérique qui autrefois faisait rêver : et Kennedy ?
Oh je ne me permettrais pas de juger, parce que c’est autre chose, c’est l’Amérique. Mais évidemment qu’à l’époque, Kennedy, il était formidable.
Le jour de son assassinat, vous en souvenez ?
Oui je me rappelle, c’était au mois de novembre, mon deuxième fils venait de partir à Oran. J’étais là, je regardais la télévision. Chez nous aussi - enfin Kennedy quand même était le représentant de l’Amérique - mais chez nous aussi il y a eu des assassinats : l’assassinat du Président Doumer sous la IIIème République, par un fou, d’un coup de pistolet. C’est comme ça... ça arrive, les désaxés.
Vous avez eu la télévision en quelle année ?
On ne l’a pas eue tout de suite, on l’a eue en 1960... 1964. Oui, mon deuxième fils était parti, moi je m’ennuyais, j’étais toute seule mais ça ne me venait même pas à l’idée tellement... l’habitude d’être seule. Et il m’a dit : « Mais pourquoi vous n’achetez pas la télévision ? ». Alors on a été l’acheter je sais pas où, une maison où soit disant on avait eu une réduction. Mais on n’était pas tous seuls, sans télévision. Et on avait la radio, quand même, on n’était pas sous développés. La radio était très gaie à l’époque, très intéressante.
Et qu’est-ce que ça a changé, la télé ?
Et bien y a l’image. Et puis quand même à l’époque c’était bien la télé, il y avait des gens de talent. Avant ça, mon fils avait un électrophone. Ça a commencé avec les phonographes, après y a eu les électrophones.
Qu’est-ce que c’est un électrophone ?
C’est un genre de phonographe mais c’est plat : il n’y a pas de cornet, il n’y a pas tout ça.
Et le téléphone ?
Le téléphone, on l’a eu très tard, parce qu’il n’y en avait pas dans l’immeuble. Mon mari était à la retraite et on l’a pris après qu’il a eu son hémiplégie. On était partis à la campagne et j’ai dit : « Faut qu’on ait le téléphone ». On l’a eu en 1966 ou 67.
Ça aussi, ça a dû être une révolution...
Oui... M’enfin on n’en a pas abusé. C’était une sécurité. On pouvait correspondre.
Avant, c’était les pneumatiques ?
Oui, c’était les pneumatiques. Mais enfin pour envoyer un pneumatique il fallait que ce soit quelque chose d’urgent. (Tic-tac de la pendule) Ça vient petit à petit, tout ça, et puis après il y a eu un tas de choses et c’est devenu tellement rapide qu’on en a oublié beaucoup...
Et la nouveauté qui a le plus compté pour vous ?
Moi ? Rien ne m’a bousculée ! (Montrant d’un geste la pièce où nous nous trouvons) Ben quand on voit où j’en suis aujourd’hui, on se doute bien que je ne cours pas après le progrès. Alors que partout, chez tout le monde, il y a tout le confort. Mais faut être chez soi pour faire des installations sinon tout reste au propriétaire. Et puis d’une certaine façon, il a fallu payer la Louptière [sa maison à la Louptière-Thénard, dans l’Aube], il a fallu la gagner. Travailler. Et qui c’est qui l’a fait ? C’est moi.
Comment vous l’avez eue, cette maison ?
C’est par des voisins de mon beau-père, qui pendant l’entre-deux guerres avait un jardin en banlieue, à Pavillon-sous-bois. C’était juste un terrain, il n’y avait pas de bâtisse, seulement une bicoque en parpaing pour y passer le dimanche. J’avais 18 ans quand j’y suis allée la première fois. Les voisins, M. et Mme B., avait un beau pavillon en bordure du terrain et avec mon beau-père ils avaient sympathisé. Mon beau-père allait les aider pour des bricoles électriques - il était électricien lui aussi. Et quand mon premier fils est né, et bien je suis allée y passer trois mois. Il n’y avait pas de confort mais il y avait un lit, une table, des chaises, l’électricité, et puis une tonnelle et comme c’était la belle saison on mangeait sous la tonnelle, les petites souris venaient grignoter les miettes ! Il y avait un réchaud à pétrole, alors vous voyez le confort... Mais on avait le jardin avec du lilas et l’eau à la pompe pour cultiver des légumes. Mme B., elle était comptable mais indépendante, donc elle avait des moments de liberté et alors elle parlait beaucoup : je passais un temps infini accrochée au grillage, à l’écouter. Et puis un jour mon beau-père est décédé, on a vendu le terrain, et eux aussi ils ont vendu leur pavillon parce qu’ils voulaient acheter plus loin pour faire un peu d’élevage à leur retraite. C’est comme ça qu’ils ont trouvé la Louptière. On est toujours restés en contact parce que j’ai toujours correspondu avec eux. Quand ils ont acheté cette maison, il a fallu refaire l’électricité et c’est mon mari qui est allé faire l’installation électrique. Et Mme B. a toujours dit « Je veux que cette maison reviennent aux petits C. » — elles nous appelaient « les petits C. » parce qu’ils avaient une génération de plus que nous et comme ils n’avaient pas de famille ni l’un ni l’autre, on était un peu comme leurs enfants. Et puis Mme B. est morte... Quand il nous a appris la mort de sa femme je lui ai répondu qu’on était là, s’il avait besoin de quoi que ce soit. Et c’est arrivé un an après, il a eu un accident cardiaque. J’y suis allée, je suis restée quatre mois près de lui. J’ai abandonné mon domicile. Quatre mois sans me voir ! Les voisins ont dû se dire « Mme C., ça y est, elle est partie ». Mon mari était resté ici avec mon deuxième fils - mon autre fils était en Algérie - et apparemment ils se sont très bien débrouillés tous seuls. Et moi je me suis occupé du monsieur jusqu’à sa mort, quatre ans après.
A ce moment vous êtes devenue propriétaire de la maison.
Oui oh vous savez : propriétaire fauchée ! Une maison de campagne, c’est un boulet. Mon mari m’avait toujours dit : « Tu verras, quand je serais à la retraite je t’offrirai un beau voyage »... Oui ben j’ai vu ! J’ai pas eu mon voyage, à la place j’ai eu le trajet Paris-La Louptière pour désherber. Qu’est ce que j’ai pu bosser ! Mais on a été très heureux parce qu’on avait un potager merveilleux, on avait chacun nos cultures : mon mari faisait du gros et moi du détail, les petits pois, les petits légumes, tout ce qui était fin. Et les fraisiers, ça c’était ma spécialité. Des belles fraises ! A l’automne chaque année je mettais des plans en nourrice que je replantais au printemps, on avait des fraises de la saison et à l’automne on avait des « fraises des quatre saisons », comme on appelait ça, des petites fraises des bois très parfumées. C’était bon. Avec mon mari, on a été dix ans très heureux parce que j’étais très forte et que je faisais beaucoup de choses. Je l’ai fait au départ parce qu’il travaillait, il ne pouvait venir qu’une fois par an. Et puis après parce qu’il était diminué par la maladie, jusqu’à sa mort. Ensuite j’ai tenu pendant trente ans toute seule. Jusqu’à 90 ans je faisais encore tout, j’étais très forte. On a même déraciné encore un saule pleureur qui avait été touché par la grande tempête [en 1999]. On a dû arracher ses racines. J’en ai arraché treize ! C’est pas rien d’arracher des racines comme ça à la hache... Oh, j’avais ma réputation là-bas : je fauchais. Alors là, ça a été une révolution à la Louptière : « Mme C. qui fauche ! » Je fauchais parce que la tondeuse ne pouvait pas passer, certaines années l’herbe était haute comme ça, c’était comme du tapis brosse, très épais. Mais il n’y a plus rien aujourd’hui, plus de potager nulle part dans le coin parce que c’était les femmes qui s’occupaient des potagers autrefois - les hommes faisaient la culture parce que c’est riche, comme terre, c’est encore la Champagne. Moi toute jeune j’avais été habituée à planter, comme ma mère avait un jardin je plantais des haricots, des choux, des salades. J’ai toujours aimé la terre... Mais il faut la travailler avant qu’elle produise et ça, c’est moins drôle. Maintenant ça se fait à la machine, tout se fait à la machine, on ne bêche plus.
Vous n’avez jamais eu envie d’aller vous installer là-bas ?
Surtout pas ! A la Louptière il y avait une dame qui avait épousé quelqu’un du pays. Ils vivaient à Paris et quand il est tombé malade ils sont venus habiter là en vue de le soigner. Mais il est mort. Et la dame me disait « Vous savez, si je pouvais retrouver seulement une chambre de bonne à Paris, je repartirai tout de suite ». Et pourtant elle n’était pas abandonnée, tout le monde s’occupait d’elle. Moi, si j’avais voulu habiter au milieu des bois, mon mari m’aurait suivie. Mais j’ai dit : « Non, on ne paie pas cher de loyer, ça sera nos vacances ». Alors quand il a été à la retraite on partait là-bas à Pâques et on revenait ici pour Noël. Pendant dix ans ça a été comme ça et c’était très bien. L’été, on vivait comme des coqs en pâte : non seulement on avait tout ce qu’il nous fallait chez nous mais on nous donnait encore. Et on avait des vélos, on allait à Sens, on allait à Nogent-sur-Seine. Il y avait des cars, on pouvait bouger, c’était facile et c’était pas cher. Il y avait tellement de commerçants... Alors que maintenant il n’y a plus rien, c’est triste. Dans le centre il n’y a plus de commerces pour ainsi dire, il faut aller au supermarché.
Qu’est-ce que ça vous inspire, les supermarchés ?
Ça plaît aux gens : on trouve tout ce qu’on veut au même endroit, ça c’est formidable. Les femmes ont acquis leur liberté, il n’y a plus de fermières, elles ne sont plus obligées de rentrer pour s’occuper de leurs animaux ! Les paysans ont vendu les vaches, avec la somme ils ont a acheté une voiture et ça y est, ils s’en vont maintenant...
... au supermarché !
Ben oui. Ça aussi, ça fait partie de l’évolution. (Tic-tac de la pendule). Mais je serais allée habiter à la Louptière, je serais à la maison de retraite aujourd’hui - il y en a une. Parce que maintenant je suis la... Comment on dit ?
La « doyenne » ?
Voilà : la doyenne du village... Dans cette maison de retraite, il y avait bien une dame qui avait quelques mois de plus que moi, mais elle est morte l’année dernière.
[Nous prenons congé d’Yvonne C. Nous la retrouvons le 28 avril 2012, de nouveau chez elle. Lorsque nous arrivons, la télévision est allumée dans le salon et diffuse à plein volume un western en VF avec Burt Lancaster et Gary Cooper (Vera Cruz, de Robert Aldrich).]
Qu’est-ce que vous regardez ?
Oh je ne regarde rien. Ça marche mais je ne regarde pas. C’est encore des feuilletons, Derick, tout ça. Mais ça ne m’intéresse pas.
[Elle va éteindre la télévision, coupant net la musique tonitruante du western.]
Il faut que je fasse régler mon machin [son appareil auditif], parce que j’entends mal, là. Ça dépend des voix, il y a des personnes que j’entends très bien mais il faut parler quand même...
FORT !
Distinctement. Il faut bien prononcer.
Vous pouvez pas le régler vous même ?
Non, il faut que je l’apporte chez mon prothésiste pour le faire régler. C’est à côté, ça va. Mais si je ne l’ai pas je n’entends rien. Avant de l’acheter, même la sonnette pourtant qui fait du bruit, je ne l’entendais plus - les gens, je les laissais à la porte. Et je n’entendais même plus le téléphone. Un jour, j’ai envoyé promener une cousine au téléphone : je lui disais « Babette parlez plus fort, je ne vous entends pas ». La pauvre, elle pouvait pas parler plus fort, alors j’ai raccroché ! Oui, parce que c’est gênant de faire toujours répéter. La pauvre... Je lui ai écrit immédiatement après, et elle m’a répondu qu’à 103 ans — j’avais 103 ans à l’époque — un petit appareil, ça m’aiderait. Enfin « petit appareil »... C’est le prix qui n’est pas petit !
Combien ?
4000 euros pour les deux oreilles ! Tout compris, je peux y aller autant de fois que je veux, c’est gratuit. Mais il faut que j’achète les piles qui me sont remboursées un an après.
Et l’appareil, il est remboursé ?
Oui, mais pas du tout intégralement.
C’est pour ça que vous avez attendu ?
Oui, je savais que c’était onéreux. Et puis c’est quand même un peu gênant. La dernière fois ce côté-là a sonné, j’étais au Bon Marché... C’est parce que la pile était usée, il fallait la changer. Alors j’en ai une dans mon sac mais vous me voyez au Bon Marché en train de changer la pile ?
Qu’est-ce que ça vous a fait d’entendre à nouveau ?
On s’habitue très vite à entendre normalement. Avant j’entendais, mais pas tout. C’est comme la télé, j’entends mais je ne comprends pas tout : c’est la façon de parler. Les gens n’articulent pas ! Si on articule bien, je comprends. (Tic-tac de la pendule)
Alors, vous avez voté ?
Bien sûr ! Mon fils m’a accompagnée. Moi je veux que Sarkozy foute le camp, je ne peux plus le supporter. J’ai voté Hollande. Parce que c’est quand même pas de la fantaisie, de voter, faut savoir pour qui. Mélanchon c’est un orateur formidable, il a réveillé un petit peu mais pour gouverner, il suffit pas de parler fort, il faut des troupes derrière.
Vous vous rappelez votre première élection ?
De Gaulle en 1946. La première élection de la Vème République, la première fois qu’on votait pour élire le président.
Et vous aviez voté pour lui ?
Ah ben oui, comme tout le monde ! Parce qu’il n’y avait plus de gouvernement avant, c’était l’Etat français, Vichy qui gouvernait avec les Allemands.
Et la première fois que vous avez eu le droit de voter ?
Oh non, je ne me rappelle pas. Ça a dû se passer comme ça, tout à fait normalement.
Et 1981, la victoire de Mitterrand ?
Eh bien c’était la fête - enfin pas pour les gens de mon âge, trop vieux pour manifester. Mais ça changeait quand même, parce qu’il y avait longtemps que la gauche n’avait pas été au pouvoir.
Vous aviez voté pour qui ?
Pour François Mitterrand. Moi personnellement je ne vote pas à droite, parce que c’est une catégorie de gens - pas tous, évidemment... - qui m’ont rendu malheureuse lorsque j’étais enfant, de par la situation de pauvreté de ma mère. Ce ne sont pas des gens qui sont pour les travailleurs. Et je reste dans ma catégorie, il n’y a pas de honte à ça. Parce que les petites gens, « la France d’en bas » comme on nous a dit, il n’y a plus personne pour la défendre. Et surtout pas Marine Le Pen : elle va quand même avec l’extrême droite de tous ces pays à l’ouest de l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, tout ça. On les a vus sur la place de la Concorde en 1934. Non, restons en démocratie : même si c’est pas la perfection, on a quand même notre mot à dire. Mais quand Mitterrand a été élu, la droite a eu peur - remarquez ils ont toujours peur. Déjà en 1936, quel bruit ça avait fait, les congés payés, qu’est ce qu’on n’a pas entendu ! Les commerçants qui avaient du personnel allaient faire faillite. Dans les journaux on nous représentait en bolcheviques, le couteau entre les dents... Mais ils nous prennent pour qui ? On n’est pas des sauvages, quand même ! On peut ne pas avoir les mêmes opinions. Celui qui a un gros capital et celui qui trime tous les jours pour gagner sa vie ne peuvent pas penser la même chose. C’est normal, il y en a un qui a peur de perdre ses sous et l’autre qui a peur de ne pas en avoir assez. Mais je ne supporte pas le mépris. (Tic-tac de la pendule - Elle montre le Canard Enchaîné posé sur la table) Ça, c’est mon journal hebdomadaire. Ça fait 83 ans que je lis le Canard. Mon beau-père le lisait, moi je le lis depuis que je suis mariée - sauf pendant l’Occupation, il paraissait en zone libre mais pas en zone occupée.
Vous devez être leur plus ancienne lectrice !
Peut-être. Encore un titre...
Quand on arrive à votre âge, on perd beaucoup de monde en route, vous avez eu beaucoup de deuils.
Ah oui... oui. Quand j’ai perdu mon mari, ça a été un mauvais moment. Il était malade mais il ne disait rien, il ne se plaignait jamais. Et puis un jour, on était en voiture avec ma belle-fille et il est mort dans la voiture. Il est mort à la tour Montparnasse. Ah ça ! Il a été exaucé parce qu’il disait toujours : «J’aimerais passer comme une lettre à la poste». C’est exactement ce qui s’est passé. C’était en soixante-quinze, j’ai mis du temps à m’en remettre. (Tic tac de la pendule). Aujourd’hui mes oncles et tantes, mes cousines, ils sont tous disparus. Ça se comprend, à 104 ans. Heureusement que j’ai eu mes petits-enfants. Ça, ça été un bonheur. Si j’avais pas tous ces enfants autour de moi, je serais toute seule. Que voudriez vous que je fasse, de la coquetterie ? Que j’aille dans les salons de thé ? Ça ne risque pas, je ne pourrais pas payer. C’est tous ces enfants-là qui m’aident, avec eux je n’ai pas le temps de penser à moi. C’est pour ça que tout le monde me dit : « Mais vous ne faites pas votre âge ! » Alors maintenant je le dis, mon âge, parce que quand je dis mon âge tout le monde change.
Les gens sont impressionnés ?
Ils sont étonnés. L’autre jour j’ai téléphoné pour faire réviser mon chauffe-eau. Ils m’avaient envoyé un avis de passage en me demandant de le confirmer, j’ai donc téléphoné pour confirmer. Je ne sais pas ce qu’ils ont fait, enfin bref ils ne sont pas venus. J’ai téléphoné, on m’a dit que c’était annulé. Il fallait prendre un autre rendez-vous. Alors j’ai dit à la dame au téléphone : « Vous savez, j’ai 104 ans... - Oh ! On ne le dirait pas à vous entendre, vous avez une voix jeune ! Je vous donne un rendez-vous tout de suite » Et à la fin elle m’a dit : « Madame, qu’est ce que je suis contente d’avoir parlé avec vous ».
Parfois, vous vous demandez : pourquoi moi ?
Mon père est mort à 74 ans, ma mère à 77 ans. Pourquoi moi ? Je ne sais pas. Quand je vais chez le médecin, il est étonné. Il me regarde comme ça, d’un air... Mais je suis arrivée à cet âge sans m’en apercevoir. Le temps est passé très vite, je ne me suis jamais ennuyée. J’avais tellement d’occupations, parce que tout se faisait à la main. Maintenant vous êtes gâtés, vous avez des appareils, mais pensez qu’une lessive, ça durait huit jours : parce qu’à l’époque on raccommodait le linge avant de le repasser. On commençait lundi, on finissait le samedi. Alors imaginez vous les femmes qui travaillaient à l’extérieur en plus, la vie qu’elles avaient. (Silence) Et c’est peut-être aussi une question de caractère, je ne sais pas, ça dépend de comment on prend la vie.
Vous la prenez comment, la vie ?
Je la prends comme elle est. Il faut pas lui demander de trop, il faut prendre ce qu’elle vous donne. Il faut faire un effort, mais il faut pas vouloir dominer le monde quand on ne peut pas. On est heureux quand même. Alors oui, j’ai mal aux pieds et puis j’ai tellement travaillé que j’ai la colonne vertébrale... J’ai du mal à marcher.
Ça vous fait peur de ne plus pouvoir sortir un jour ?
Il le faut, sortir, mais pour ce qu’il y a à voir dans la rue... Le spectacle est pas tellement beau ! Si : je vois les grues sur le chantier d’en face, eh bien ça, ça m’intéresse figurez-vous. Les grues se reflètent dans la fenêtre en face, la nuit quand je me réveille, c’est tout éclairé. Elles passent par-dessus l’immeuble, elles sont très hautes... Alors quand je fais ma pause à l’arrêt de bus je suis juste en face, je regarde, ça me plaît. J’aurais aimé avoir un petit-fils ingénieur.
Yvonne, quand vous rêvez, c’est d’aujourd’hui ou de temps lointains ?
Oh les rêves, c’est extraordinaire. On peut revoir certains visages. Mais mon mari, je ne l’ai jamais revu en rêve. Comme mes parents. Parce que dans les rêves, parfois, les personnages portent les noms des gens qu’on a connus, mais ils n’ont pas leurs visages. (Tic-tac de la pendule) Vous savez, le cerveau, c’est extraordinaire. Comme dans ma vie j’ai beaucoup tricoté, je me souviens d’un pull que je faisais pour un de mes arrière-petits-fils. Je n’y arrivais pas, au lieu de faire des mailles à l’endroit, dans mon idée c’était des mailles à l’envers qu’il fallait faire. Mais elles n’étaient pas placées où il fallait, je n’y arrivais pas.... Et bien j’ai trouvé l’astuce dans mon sommeil : je me suis levée, j’ai fait exactement ce que j’avais rêvé et c’était ça ! J’avais lu qu’un horloger réparait ses réveils comme ça, dans son sommeil - eh bien moi, c’était le tricot.