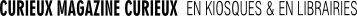


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


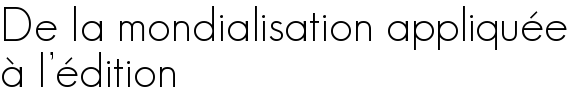
 |
|
|
Publié dans le
numéro 006 (juin 2011)
|
On ne vient pas par hasard à Issy-les-Moulineaux, deuxième poumon économique des Hauts-de-Seine après La Défense [1] et fief électoral d’André Santini [2] : dans le RER du lundi matin, à part quelques touristes japonais qui prennent la direction du château de Versailles, les tailleurs et les cravates forment l’armée de cols blancs qui font vivre quelques-unes des plus prestigieuses multinationales françaises et étrangères installées sur le territoire de la commune.
Une fois le RER C arrêté au quai de la station d’Issy Val-de-Seine, la meute de travailleurs se précipite vers les tours de verre des Hewlett-Packard, Bouygues et autre France 24. Le petit escalier qui mène au croisement de la rue Camille-Desmoulins et de la rue Rouget-de-Lisle bloque le flux humain. Fascinant spectacle de « la France qui se lève tôt » et qui court au travail. Au bas de l’escalier le flux se disperse, éclate, se dissémine, laissant derrière lui plusieurs groupes de travailleurs en colonne, et finit par se muer en un ensemble de petites unités, qui chacune se rend d’un pas alerte gagner son salaire. Puis plus rien, ou presque. Seuls restent sur le pavé les employés de la presse gratuite, en casquettes et K-way colorés, comme des bouées qui attendraient la prochaine marée.
Je ne m’éternise pas sur ma cigarette : je m’en vais moi aussi rejoindre ma boutique, Elsevier-Masson, maison d’édition spécialisée dans le domaine médical. Je termine un CDD de huit mois. C’est le moment de mettre en forme les notes que j’y ai prises et les témoignages des personnes que j’ai croisées ici.
Comme toutes les grosses entreprises d’Issy-les-Moulineaux, la mienne est « badgée ». Plusieurs fois il m’est arrivé d’oublier mon badge. Grave erreur : cela signifie pas d’ascenseur, pas de portes qui s’ouvrent, pas de croissant le matin, et pas de déjeuner à la cantine. Sans badge, tout se complique. « Quand on est visiteur, me glisse un médecin qui s’occupe d’une revue éditée par le groupe, on a l’impression de ne pas faire partie du même monde, de ne pas avoir accès aux choses ici. Le moins qu’on puisse dire c’est que ce n’est pas une atmosphère de travail des plus saines. Je regrette quand même le boulevard Saint-Germain ». Avant d’être rachetée, Masson était installée au quartier Latin, adresse aristocratique, au milieu des universités. Un employé raconte : « Tout le monde était en costume, nous étions une maison sérieuse et reconnue. Il y avait un certain prestige à bosser chez Masson. » À l’époque, c’était le directeur qui recevait les nouveaux salariés. On me décrit une ambiance familiale, sérieuse et soucieuse de la qualité des livres et revues édités. Aujourd’hui, les déambulations se font sous l’œil des caméras vigilantes, les réunions se tiennent dans des espaces vitrés au milieu des couloirs et les secrétaires de rédaction ont presque toutes été remplacées par des logiciels automatisant leur travail. Air désormais connu : celui de la mise sous tutelle d’entreprises familiales à forte valeur ajoutée, dont cette histoire n’est qu’une petite chronique.
C’est l’histoire d’une vieille maison : Masson, bien connue des chercheurs, médecins et étudiants. Masson a plus de deux cents ans : fondée en 1804 sous le nom de « Librairie scientifique et médicale » et sise rue de l’École-de-Médecine, à Paris, elle est alors spécialisée dans la publication des travaux et comptes rendus de la Société de Médecine, qui siège à deux pas. L’éditeur ne changera plus de public, ni de vocation : en 1846, elle est rachetée par Victor Masson qui lui donne son nom et son envol. Masson publie des livres de médecine, de « science naturelle », de chimie, d’agriculture. Au tournant du nouveau siècle, après cent ans ans d’existence, la maison familiale est un petit empire : son fleuron, La Presse médicale, accompagne le foisonnement de la science moderne, qui, comme il se doit, s’exprime via revues et périodiques. Masson les multiplie (54 en 1939, 150 dans les années 1980) et en fait le cœur de son activité. Ce sont, bien sûr, des revues très sérieuses. On ne lit pas les Cahiers de radiologie, le Cahier de l’infirmière, Gynécologie obstétrique & fertilité ou la Revue de médecine légale par hasard : il faut être spécialiste, ou alors très curieux. Aujourd’hui Masson édite aussi des cours, des fiches, des QCM. En France, c’est la référence en matière médicale. Par sa position au carrefour de l’édition, de la recherche universitaire et des cours pour étudiants et futurs médecins, Masson est une entreprise stratégique, une vitrine de la recherche médicale française.
En 1998, Masson connaît un premier tournant : l’entreprise est cédée par ses propriétaires, héritiers plus ou moins directs de Victor Masson, à Havas, filiale de Vivendi. Rien de renversant : elle suit sa marche tranquille, sans souffrir beaucoup de cette absorption par le géant français des médias. Les méthodes et les équipes restent les mêmes. Ce n’est rien à côté de ce qui va arriver à partir de 2002. D’abord, Médimédia, la filiale de Havas dans laquelle Vivendi avait agrégé ses différentes publications médicales (dont le Quotidien du Médecin ou le dictionnaire Vidal), est revendue à plusieurs fonds d’investissements. Puis, en 2004, Médimédia elle-même commence à se séparer de ses diverses branches, et Masson est revendue en 2005. Elle fusionne avec l’anglo-néerlandais Reed-Elsevier, plus de cinq milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2009, second éditeur mondial et numéro 1 des publications médicales et paramédicales - un gros, un très, très gros Masson. Elsevier [3] est aussi la maison-mère du célèbre Lancet, la revue médicale la plus ancienne et la plus prestigieuse au monde [4]. Masson devient « Elsevier-Masson » : le prestige de la petite maison est tel que la grande boutique ne peut pas se permettre de lui retirer complètement son nom.
C’est donc à partir de 2005 que les choses commencent à devenir drôles - ou tragiques. Masson doit dare-dare s’adapter aux business plans d’une global company, qui veut réduire ses coûts et réformer ses process de production. C’est l’histoire du capitalisme mondialisé, qui s’introduit partout, y compris - et surtout - là où on ne l’attend pas, dans une maison d’édition qui publie la Revue de pneumologie clinique et le Journal de chirurgie viscérale. C’est l’arrivée, imprévue et arrogante, du management par la peur, des délocalisations à six mille kilomètres, des licenciements sous forme de décimation : c’est fou, ça rend fou, ça se passe à Issy-les-Moulineaux.
Elsevier embauche à la tête de sa nouvelle filiale « France » le patron de Masson. A priori donc, la fusion-acquisition ne sera pas trop douloureuse. Oui mais voilà. Il faut imaginer deux entreprises qui fusionnent : un jour, on met les troupes devant le fait accompli et on organise la « rencontre ». Les employés de la grande boutique arrivent, telle une équipe de football, avec le T-shirt d’Elsevier. Les « anciens » de Masson, et c’est légitime, prennent peur : qui sont ces énergumènes qui débarquent tous avec le même T-shirt orange, assez fiers de leur entreprise pour en arborer les couleurs ? Vont-ils nous chanter un hymne ? se demandent certains. On boit un coup, on fait connaissance, mais on ne sait pas encore à quoi s’attendre. Très vite, les employés Masson comprennent. Il ne s’agit pas d’un échange, comme on voudrait le leur faire croire, ni d’une « fusion » comme l’indique l’intitulé de l’opération capitalistique, mais bien d’une guerre des pratiques. Des groupes de travail sont organisés pour veiller à la bonne assimilation des méthodes de travail d’Elsevier par les employés de la petite maison d’édition. Les premières inquiétudes se font jour. Chez Masson, on parlait de préparation de copie, de maquette, de jeux d’épreuves, d’appels à l’imprimeur, de négociations serrées avec les fournisseurs. Côté Elsevier, on répond, le regard sans vie, « technical check », « validations de process » et « style sheet ». La déshumanisation du travail commence par le langage : le procédé est classique. Ces barbarismes en anglais standardisé désignent les procédés par lesquels transitent les manuscrits des scientifiques - mais les mêmes mots pourraient convenir à la fabrication de n’importe quel produit.
Le parcours d’un article est devenu des plus sinueux, mais ça coûte moins cher qu’avant. Rédigés par des chercheurs travaillant pour la plupart en milieu hospitalier, tout article susceptible d’être publié est d’abord soumis aux rédactions des différentes revues éditées par Masson via un « logiciel de soumission » en ligne. Tous les contacts entre l’auteur et la revue se font via le logiciel, qui envoie des mails automatiquement - parfois un peu au hasard s’il est mal configuré. L’article soumis par le chercheur est envoyé aux relecteurs, des spécialistes choisis par la rédaction. Une fois validé par le rédacteur en chef, l’article est transféré sur un autre logiciel, de production celui-ci. Le logiciel envoie les papiers validés pour publication, en « préparation de copie »... chez des correcteurs de l’île Maurice. Ceux-ci expédient l’article en Inde, où d’anonymes maquettistes le mettent en page. Cette étape cruciale et finale de la production de la revue doit donc être gérée par les « journal managers » à six mille kilomètres de distance. Les Indiens réalisant des maquettes à la chaîne, sans se soucier des spécificités de chaque revue ni de chaque rédaction, les mêmes problèmes techniques et incompréhensions se reproduisent à chaque fois. Son tour du monde effectué, le manuscrit revient en PDF à l’auteur et au rédacteur en chef pour la seule et unique relecture avant publication.
J’ai pu moi-même éprouver ce système automatisé. Un article pose des problèmes de mise en page. Naïvement, je déclare à mon journal manager : « Où est le problème ? Il suffit de mettre cette photo ici et celle-ci là. Donnez-moi InDesign [logiciel de mise en page], ce sera réglé en cinq minutes ! ». Mon interlocuteur me regarde comme si j’étais un Inuit débarqué à Paris, et me rétorque, blasé : « Tu as vraiment cru qu’on faisait de l’édition ? » En fait de maison d’édition, Elsevier-Masson est devenue, selon les termes d’un ancien employé, « un gigantesque gestionnaire de base de données. Et les données, ce sont les articles ». Comment les rédactions, composées d’éminents scientifiques, vivent-elles ces changements ? La réponse m’est donnée quelques semaines plus tard, lors d’un comité de rédaction. Le rédacteur en chef, un médecin, extérieur à Masson, mécontent du système automatisé, se lance dans une diatribe contre l’éditrice de sa revue : « Je refuse qu’on impose, sans nous demander notre opinion, un système anglo-saxon à une revue francophone ! C’est du colonialisme ! Les gens qui s’en servent perdent leur âme ! » Décontenancée par la véhémence du propos, l’éditrice botte en touche : « Je travaille pour cette entreprise, et vous comprenez bien que je ne peux pas vous servir un autre discours que celui de la direction. » Le rédacteur en chef : « Vous nous faites souffrir et ça ne vous inquiète pas outre mesure. Nous n’avons pas que ça à faire, nous soignons des gens, et vous nous emmerdez, vous nous prenez pour des débiles ! »
En interne non plus, ces changements ne sont pas bien vécus : les secrétaires d’édition-maquettistes [5] n’ont pas survécu, les secrétaires de rédaction [6] ont vu le nombre réduit de deux tiers, et les éditeurs n’ont presque plus de marge de manœuvre sur la gestion de leurs revues. Plus question de choisir un papier, une maquette, de travailler en accord avec les rédacteurs en chef ou l’imprimeur : il faut désormais choisir une maquette parmi un panel de cinq modèles. Le circuit des articles dans les méandres du système est choisi parmi trois niveaux de complexité, selon l’exigence et l’importance des rédactions. Plus question de travailler les textes. « On nous a clairement fait comprendre, raconte une employée de production, que nous ne sommes plus responsables des textes. S’il y a des coquilles, des images dégueulasses, des erreurs dans les références, c’est la faute de l’auteur, ou celle du fournisseur [le prestataire qui fait la préparation de copie à l’île Maurice]. Un jour j’ai essayé de poser une question, on m’a dit : Tu t’en fous de la rédaction ! C’est quand même un comble, non ? une maison d’édition qui se fout du texte... »
De 2006 à 2008, l’entreprise licencie des salariés lors d’un premier plan social, mais c’est en 2009 qu’intervient un plan social d’envergure. « Nous l’avons senti venir, raconte un salarié, nous avons bien compris que les secrétaires de rédaction ne servaient plus à rien. » Là encore, le management moderne a ses euphémismes : on ne parle plus d’employés mais de « collaborateurs », les licenciements sont remplacés par des « départs volontaires » et la restructuration par la « réorganisation ». Le choc est pourtant violent : les middle-managers, coincés entre la direction et les salariés, qui subissent les pressions des deux côtés et évitent que les problèmes remontent trop haut dans la hiérarchie, se voient même proposer des formations de « vaillance ». Comment doit réagir un manager convié à une formation de deux jours sur la « vaillance » ? Doit-il comprendre le mot au sens de la « vertu dont fait preuve le guerrier courageux face au danger », du « courage moral que l’on manifeste face à l’adversité, à la douleur, aux difficultés de la vie », ou de la « vigueur physique, l’énergie, l’ardeur à vivre et à entreprendre » ?
Pour mener à bien son plan social, la direction a organisé un audit au cours duquel elle a calculé le temps de travail des différents postes, pour mieux pouvoir écrémer les tâches superflues, voire inutiles. Elle autorise les délégations syndicales à constituer un groupe de travail de douze salariés, qui réalise un contre-audit et présente ses conclusions à la direction. La direction prend acte des propositions du groupe et revient, deux semaines plus tard, avec ce qui aurait du être un projet amendé. Là, le groupe de travail, tel les Twelve Angry Men de Sydney Lumet, se voit présenter par la direction le même plan, avec les mêmes chiffres et les mêmes licenciements. Parmi les Douze hommes en colère, il y a toujours un Henry Fonda qui ne se laisse pas faire. Le salarié furibard monte au créneau, se lève et balance au nez des décideurs : « Vous auriez pu vous torcher avec, ç’aurait été la même chose ! » Il apprendra plus tard que les licenciements étaient décidés d’avance, dans leur principe et même leur nombre : c’est précisément pour accomplir cette tâche que le patron de Masson a été reconduit par la nouvelle direction en 2005. Dès lors, le « groupe des douze » n’a plus vocation à sauver des postes mais à négocier les conditions de la reddition : des formations, bilans de compétences et mutuelle pour les salariés licenciés, et une prime de départ négociée « comme au souk » selon « Henry Fonda », qui conclut : « Le parallèle va te paraître exagéré, mais j’avais l’impression d’être dans le 1984 d’Orwell. C’est-à-dire que la direction, en prenant le parti de proposer des négociations, de nous donner l’opportunité de faire des propositions alternatives, crée sa propre résistance pour mieux la contrôler et l’étouffer. Ça n’a été qu’une grande comédie destinée à éviter un clash frontal. C’est une machine très bien pensée. » Un ancien salarié licencié revient sur cet épisode : « C’est quand même incroyable : on vous impose des formations pour vous dire que vous devez vous éclater au travail, que ce que vous faites est génial, et deux semaines après vous recevez un mail qui annonce un plan de licenciements massif. »
Quid de ceux qui restent ? On les charge comme des mules. Une employée de production raconte qu’elle est passée, d’un jour à l’autre, d’une trentaine de revues à gérer à plus de cinquante. Mais elle tempère immédiatement : « Que puis-je dire ? J’ai presque cinquante ans, il faut que je paie mon appartement, j’ai besoin de mon boulot, je ne veux pas le perdre. » Ne restent donc que des salariés tétanisés à l’idée d’être licenciés, ou d’autres effrayés de rester. Et ceux qui se rebiffent ? « On nous fait clairement comprendre où se trouve la sortie », raconte une autre salariée de production. Soucieuse de la santé morale de ses « collaborateurs », l’entreprise Elsevier-Masson a mis en place une « cellule de soutien psychologique », gérée par une spécialiste du stress au travail. Ses solutions ? Être bien dans sa vie privée : une vie familiale stable, faire du sport, avoir des loisirs épanouissants. Le stress et la violence du travail sont devenus un fait naturel avec lequel il faut composer. Une employée confirme : « Évidemment qu’avec une vie privée saine et stable on vit mieux ces événements. Il n’y qu’à voir, ceux qui sont en détresse psychologique n’ont pas de vie privée épanouie. Mais il ne faut pas se leurrer, ça touche tout le monde. À l’annonce de la mise en place de cette cellule, vingt personnes sur vingt-quatre dans mon service ont fait une demande d’entretien avec la psy en quelques semaines. »
Cette stratégie de la tension, ce management par la peur, se justifient au regard du nouveau business model imposé par la nouvelle P.-D.G. du groupe France, Stéphanie van Duin. Un modèle orienté vers l’édition électronique, tablettes et smartphones, et dans lequel le papier, la maquette, la reliure, sont d’une désuétude méprisable. Les petites revues, qui pourraient pourtant bénéficier de cette orientation vers la dématérialisation des contenus, sont vouées à l’abandon : elles ne génèrent pas assez de chiffre d’affaires en revenus publicitaires ou en abonnements. Quand je pose la question à un éditeur, il se rend à l’évidence : « C’est une petite revue, elle a du mal à rentrer dans le moule et génère très peu d’argent. Elle finira par partir chez le concurrent, mais finalement est-ce que ce n’est pas ce que veut la direction ? Se débarrasser des petites revues pour aller vers de l’électronique avec les grosses. Tout cela suit une certaine logique. »
Avant les fêtes de fin d’année, on offre du cidre aux salariés, pour accompagner la galette des rois. On ne se mélange pas : la production avec la production, l’éditorial avec l’éditorial, les RH avec les RH. La « pédégère » passe dans les services comme on inspecte les bataillons, pour « trinquer ». Aux éditeurs, la chantre de l’édition numérique annonce de bons chiffres, une bonne croissance, « même s’il faut encore faire des efforts ». À la production, un discours moins engageant : « Je sais que cette année n’a pas été facile pour tout le monde, commence-t-elle. Mais il faudra encore se serrer les coudes et continuer à aller de l’avant. » La voix un peu tremblante, le teint blanc, serrée dans son tailleur, elle doit sentir le poids du regard de ceux de la production, qui attendent de l’unique discours annuel de la direction une annonce quelconque, un mot positif. « C’est difficile de devoir se séparer de certains collègues, continue-t-elle, mais c’est la seule solution que nous avons, et la crise n’arrange rien. » Tout le monde ici sait bien que la crise n’a rien changé pour l’édition médicale, que c’est un secteur qui croît doucement, mais sûrement. Les lecteurs sont des spécialistes, des universités, des écoles, ils continueront de s’abonner.
Les salariés restent là, certains se plaignent de n’avoir eu que du cidre, alors « qu’avant on [leur] offrait le champagne ». Rigueur des temps ?
[1] Avec environ 50 000 emplois, INSEE 2009.
[2] André Santini, 70 ans, est maire (Nouveau Centre) d'Issy-les-Moulineaux depuis 1980, et député des Hauts-de-Seine depuis 1988 avec quelques interruptions dues à ses différents portefeuilles ministériels.
[3] Les publications scientifiques et médicales de Reed-Elsevier sont publiées sous la seule marque d'Elsevier.
[4] Elsevier a racheté The Lancet en 1991
[5] Dans une maison d'édition, le secrétaire d'édition est chargé de la réalisation finale des ouvrages, en lien avec les auteurs et la production.
[6] Les secrétaires de rédaction sont chargés de la mise en forme des textes avant leur impression.