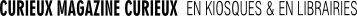


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


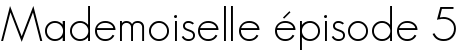
 |
|
|
Publié dans le
numéro 005 (Mai 2011)
|
« Bonjour Elena, vous allez bien ? » Une liasse d’affichettes « 3 Jours en Or » serrées contre son cœur, la chef de rayon passe à côté de moi sans un mot, pas même un regard. « Ohé ? Elena ! » Drapée dans son tailleur noir, elle me tourne le dos et s’éloigne d’un pas pressé. « Ayant pris la forme du magnanime Stentor à la voix d’airain, la divine Héra s’arrêta et lança un grand cri » (L’Iliade, chant V). Comme la déesse aux bras blancs prête massacrer les Troyens, de derrière la caisse je lance un grand cri, un cri féroce qui s’élève, explose et retentit aux quatre coins du stand, faisant tressaillir les plus braves de mes clientes et poussant la craintive Dany Levy, retranchée au fond d’une cabine d’essayage, à passer sa figure alarmée par l’entrebâillement du rideau - « Je vous parle ELENAAA ! » De l’autre côté de l’allée, elle se retourne, stupéfaite : « Emilie... C’est moi que vous appelez Elena ? »
Depuis cinq mois, j’écris en secret sur les Galeries Lafayette et jusqu’ici personne ne s’est douté de rien, les Fleuves m’ont laissée descendre où je voulais. Tôt ou tard, je m’attendais à tomber dans les filets du service presse, à être démasquée par une cliente, reconnue par une collègue, confondue par une lectrice. Rien de tel : ma langue a fourché. Lapsus, « relâchement de l’action inhibitrice de l’attention » décrivait Freud, « à nos actes manqués ! », chantait J-J. Goldman. Quand je comprends que, si près de la fin, je viens de vendre la mèche en appelant N. par son pseudonyme dans le feuilleton, je passe du rouge au blême, par toutes les couleurs de la honte. Elle est blessée, et avec son léger accent russe qui fait rouler les « r » comme de petits galets, elle me dit tristement : « il vous a suffi de deux jours pour oublier mon prénom... » J’aimerais lui expliquer pourquoi Elena, lui avouer qu’hier j’ai écrit un épisode où il était question d’elle et que c’est un peu comme d’embrasser quelqu’un en rêve, au matin il reste une trace. Mais je bafouille « pardon... fatiguée... travaillé... » Elle hausse un sourcil pour obtenir des précisions, je prends le prétexte de ma thèse, du bout des lèvres elle m’en demande le sujet, je réponds « la séduction au cinéma ». Son visage s’illumine : « Vous êtes sociologue ? » A son tour, elle me parle de ses études en sociologie des organisations et de son arrivée en France pour faire un doctorat qu’elle a fini par abandonner : « Mon directeur m’avait imposé un sujet sinistre alors quand ma demande de bourse a été refusée, je n’ai pas eu le courage de continuer... Mais la séduction ! » Les yeux brillants, elle me raconte une scène de Lost Highway : sur la voix de Lou Reed, Patricia Arquette gainée de satin noir jette un regard magnétique à un pompiste qui, de désir, se mord la lèvre. Exaltée, N. se met à fredonner « this magic moment while your lips are close to mine » et, alliant le geste à la parole, elle me décoche une œillade brûlante en faisant virevolter sa coupe au carré. Mais soudain, attaquant par l’Ouest, Laurence Truissard fait irruption sur le stand. En un instant le sortilège est rompu : N. la vénéneuse redevient Elena, la chef de rayon consciencieuse et austère et, les yeux éteints, elle retourne parler chiffre d’affaires prévisionnel, panier moyen, code EAN.
Il est midi quand la nouvelle finit de se répandre : hier, à la fermeture, quelqu’un de l’étage s’est fait prendre pour vol. Avec Lucile et Cindy, nous passons les absentes en revue. « J’espère que c’est pas Sylvia, elle est pas là depuis ce matin... » s’inquiète Lucile. La semaine dernière déjà, Alexandra, la jeune responsable d’un stand voisin, avait été arrêtée à la sortie par un vigile qui l’accusait à tort. L’ayant vue sur la vidéosurveillance débiper une ceinture pour l’essayer, il a attendu qu’elle finisse son service et, au moment où elle franchisait les bornes de pointage, l’a saisie par le bras en lui disant : « La Spéciale, suivez-moi ». Il l’a poussée vers la petite porte rouge, à gauche de la sortie du personnel, et sans un mot d’explication l’a entraînée dans les couloirs du sous-sol, jusqu’à la salle d’interrogatoire. « Il voulait rien me dire, je savais pas pourquoi il m’emmenait. Ma mère m’attendait dehors, on devait aller voir ma sœur à l’hôpital. En bas y avait pas de réseau, je pouvais même pas l’appeler pour la prévenir. J’ai commencé à flipper », nous a ensuite raconté Alexandra. Pendant plus d’une heure, avec un autre vigile, ils lui répètent : « on t’a vue, avoue », tout en refusant de fouiller son sac comme elle le leur propose, excédée. Après maintes explications et reconstitutions des faits, du bruit et de la fureur, elle obtient enfin de pouvoir s’en aller. Le lendemain, le grand patron de la Spéciale, un élégant géant martiniquais, venait en personne présenter ses excuses à Alexandra, souhaitant sans doute éviter les conséquences de la bavure.
Je pars déjeuner en oubliant d’enlever mon badge. Sur le trajet vers la sortie, une inconnue me barre la route : « Armani Jeans ? ». Je réponds que 1) je ne sais pas 2) comme l’indique le fait que j’ai un blouson sur le dos et un sac sur l’épaule, je suis en pause. La femme s’égosille en direction de sa comparse : « Elle dit qu’elle est en pause, elle veut pas répondre ! »
Rue de Provence, je rencontre Soizic. Bouleversée, elle me demande si je connais Mme Taillerand. « C’est une très bonne cliente, elle vient chez toi aussi. Tu sais, une belle femme, quarante, quarante-cinq ans, grande, élégante... Elle peut tout porter, sur elle rien ne fait vulgaire. Eh bien y a à peine cinq minutes, je sors du japonais rue Joubert et là, sous le porche, qu’est-ce que je vois ? Mon bonnet, mon gilet, les cuissardes que je lui ai vendues... Mme Taillerand en train de faire le tapin ! » Soizic, qui la connaît depuis des années, savait bien qu’elle habitait rue Joubert mais ne s’était jamais douté qu’elle puisse se prostituer. « Elle devait recevoir ses clients chez elle, sinon on l’aurait déjà vue. Tu te rends compte ? Du jour au lendemain, être obligée de se mettre sur le trottoir, comme ça, avec les macs et toutes les putes... » Quand elle a vu Soizic, Mme Taillerand s’est détournée. Soizic, elle, a fait semblant de ne pas reconnaître sa bonne cliente occupée à guetter le client.
Entre la vitrine de lunettes de soleil et l’espace des caleçons pour homme, sur la passerelle, je fais un détour par les toilettes publiques. Ici, pas de grand valet de pied en train de se brosser les dents mais une vieille dame qui, ayant repéré entre mon col et mon écharpe quelques centimètres de badge, m’interpelle : « S’il vous plaît ! Il n’y a plus de papier, vous pouvez en remettre ? »
Sur le stand d’Eric, les dernières notes de « Je t’aime, moi non » plus s’enchaînent avec la voix de Mistinguett qui gouaille à plein volume « il m’a vue nue, toute nue, sans cache-truc ni soutien-machin, j’en ai rougi jusqu’aux vaccins ! Il m’a vue nue, toute nue, il était parti comme un dard, mais je n’ai pas eu de retard ».
Je retrouve Cindy et Lucile rassurées : la disparue d’hier soir est une fille que nous connaissions peu. « La pauvre, elle s’est fait virer pour un soutif et un string... », dit Gladys sur un ton compatissant. « Quand tu sais pas voler, vole pas », rétorque Cindy.
Deux « merchandisers » munies de ciseaux et de peignes, l’une perchée sur une échelle, l’autre à terre, posent des perruques rétro sur les crânes chauves des mannequins de l’allée. Avec Cindy, nous en empruntons une pour l’essayer : je ressemble à un Playmobil de l’ère pompidolienne, Cindy à Françoise Sagan en brune. Pendant vingt-cinq minutes, nous rions. Au moment où je ressors de la cabine en séchant mes larmes, celle que nous continuerons d’appeler Elena, autrefois surnommée à l’étage « l’œil de Moscou », traverse le stand à l’improviste. « Voilà ce que c’est, d’embaucher des sociologues ! » me lance-t-elle avec un sourire complice avant de s’assombrir : « Vraiment, Emilie, faites très attention : la direction tourne dans le secteur, vous pourriez avoir des problèmes... Ces derniers temps, ils nous mettent le couteau dans la gorge ». Dès qu’elle a le dos tourné, Cindy constate avec satisfaction : « Avant, c’était une barre de fer. Elle a vu qu’elle gagnait pas, elle s’est détendue ».
Une quadragénaire à lunettes, cheveux courts, jean et chemise blanche, achète un jean et une chemise blanche. À la caisse, je lui tends une carte de visite de la marque avec Kate Moss en photo. Elle s’exclame : « Encore Kate Moss ! Il y en a tellement qui passent et qu’on oublie. Elle, elle reste... » Puis, sur un ton proverbial : « Dans la vie, faut sucer les bonnes bites ».
Un homme d’une quarantaine d’années et une femme plus jeune, tous deux blonds, athlétiques et bronzés, viennent acheter un pantalon de jogging rose malabar. Pendant qu’elle essaie, l’homme est au téléphone - « Je te remercie, ne t’inquiète pas ce sera fait, ne te fais pas de souci, je te remercie... ». Au moment de payer il sort de sa poche une enveloppe pleine d’énormes billets, me dit « merci infiniment » en récupérant son sac et, se tournant vers sa copine : « Tout à l’heure je vois Samuel. Lui, je vais lui couper la tête ».
Je fais un sempiternel tour de manège pour arranger les cintres sur les barres : « refaire le merch’ », comme on dit dans le milieu, est une des idées fixes de Lucile. Régulièrement, s’en prenant à celle qui, de Cindy ou de moi, a le malheur d’être à sa portée, Lucile martèle d’un ton de maîtresse d’école - ou de meneuse de revue : « Les filles ! Les cintres, c’est pas toutes les heures, c’est pas toutes les demi-heures, c’est pas tous les quarts d’heure : c’est tout le temps ! » Aussi, pendant que je caresse avec zèle chacun des cent cinquante-huit cintres qui s’alignent sous sa responsabilité, elle me couve des yeux en m’encourageant : « C’est bien mon chaton, continue comme ça »
Un magnifique vieillard chinois me montre du doigt, au plafond, la pancarte représentant l’ascenseur. A mon tour je lui montre du doigt l’ascenseur, à deux mètres derrière lui. Nous nous dévisageons un instant sans bouger. De nouveau, il me montre le dessin là-haut, je lui montre l’ascenseur derrière. Enfin, d’un commun accord, nous nous faisons un sourire radieux.
Tout au bout de l’allée déserte, il fait nuit depuis longtemps dans la lucarne du salon Cofinoga. A l’arrière, Nisrine, les bras chargés de vêtements, remplit tant bien que mal un verre en plastique à la fontaine à eau. Elle le boit d’un trait puis, le regard dans le vague, elle reste un moment immobile, son grand corps las des fatigues du jour.
Lentement je parcours une fois encore les soixante-quatorze pas qui me sépare de la réserve. En chemin je croise Elena prête à s’en aller. Devant moi, elle brandit un épais dossier gris : « Vous voyez, je n’oublie pas la régulation de votre C.A. de mars. Mais ici c’est pas facile de se concentrer, mon téléphone sonne tout le temps. J’ai essayé d’aller travailler dans la pièce derrière le sous-marin, mais une souris est tombée du plafond ! Alors je l’emporte chez moi... Ça me rappelle le temps où j’étais sociologue ».
Sur le stand en face du mien, Eric fait les derniers gestes de la fermeture, les mouvements d’automate que depuis des années il répète chaque soir. Il a laissé la musique tourner tout bas et, dans le silence du grand magasin, on entend la voix de Mistinguett qui chantonne en sourdine « Oh ! Mademoiselle ».
En partant, pour la première fois, je lève les yeux vers le ciel bombé de la coupole.