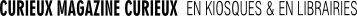


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


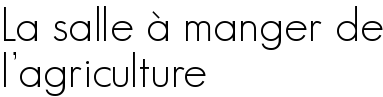
Un entretien réalisé le vendredi 19 février 2010 au Musée de la Chasse & de la Nature (Paris IIIe) par Lætitia Bianchi avec Claude d’Anthenaise, conservateur en chef du musée.
Photographies : Rémy Artiges
Avez-vous l’impression d’une surenchère récente dans la représentation par le Salon de l’agriculture d’une nature aseptisée ?
Oui, tout à fait : il y a une dizaine d’années, le Salon était avant tout un salon professionnel alors que le site internet 2010 dit par la négative, « un Salon grand public qui demeure une rencontre privilégiée entre professionnels de toutes les filières agricoles ». Il y a actuellement une surenchère des techniques publicitaires. Les animaux sont de plus en plus lustrés. La photo qui ouvre la série de Rémy Artiges est révélatrice : on ne sait si le cheval dont on aperçoit la croupe va au salon de coiffure ou si on est en train de le gonfler à l’hélium. En tout cas, on est bien loin des techniques d’élevage. Tout cela pour fabriquer une image acceptable par le public, « cosmétiquée ». Et effectivement, il y a une vingtaine d’années, je me souviens qu’à l’heure du Salon, le métro sentait la vache en revenant de la porte de Versailles... Ce qui n’est plus le cas — enfin bon... je ne prends peut-être plus la même ligne...

D’où l’évolution du Salon de l’agriculture, qui devient Salon de l’image de l’agriculture...
Quelle est l’image du monde agricole aujourd’hui ? Justement, il n’y a plus d’image — ou une image complètement brouillée, comme si elle résultait d’une superposition de profils contradictoires. On a longtemps collé au monde agricole l’image rassurante de garant des traditions et de gardien des paysages : labourage et pâturage. Depuis longtemps déjà c’est une utopie, plus ou moins bien acceptée. Des courants d’opinion très critiques sont apparus dès le xixe siècle : La Terre de Zola donnait par exemple une image sordide de la campagne, aux antipodes de ce que véhiculait la littérature bien pensante. Aujourd’hui, bien peu d’écrivains traitent de l’harmonie du paysan avec la nature... Et si les films de Raymond Depardon ne sont pas totalement étrangers à la nostalgie, ils ne donnent pas une vision très positive du monde rural. De toutes parts, il y a une remise en cause. Ce sont peut-être les agriculteurs qui ont d’ailleurs le plus efficacement contesté l’étiquette de la tradition qu’on leur avait collée au dos. Ils ont voulu se défaire de cet habit passéiste et ont revendiqué le statut moderne d’entrepreneurs et de techniciens. Mais cela ne fait pas l’affaire des industries agroalimentaires qui savent bien que rien ne vaut la saveur du terroir pour faire vendre. Comment assurer la cohérence de ces deux images ? Le Salon a opté pour une surenchère dans l’évocation bucolique : « Le bonheur est dans le pré. » La ficelle est grosse, et usée.
Une ficelle que montrent les photographies de Rémy Artiges...
Oui, c’est précisément le talent de Rémy Artiges de débusquer les artifices de cette construction. En photographiant les décors faussement champêtres plaqués sur les murs de parpaings, il exprime le malaise du monde agricole, le désarroi du travailleur de la terre. Celui-ci n’est plus à l’aise dans le costume de velours élimé qu’on lui fait porter pour l’occasion : le déguisement du paysan. La distance est désormais inconciliable entre le modèle et le portrait. Un trop grand écart s’est créé entre ce qu’on essaie de vendre, ce sur quoi on s’appuie, et la façon dont le public le perçoit. L’utopie de la ruralité n’opère plus. C’est précisément cela qui n’est pas sans risque : quand on cesse de croire aux représentations comme ça, il faut passer par autre chose.
Mais les visiteurs du Salon les voient-ils vraiment, ces ficelles ?
Vous avez raison : les visiteurs du Salon veulent y croire encore. Cela relève de l’acte de foi. Ils acceptent de prendre cette image de la campagne pour la campagne elle-même.
Dans quelle mesure ont-ils besoin de cette construction de la nature ?
La nostalgie de la nature est un fruit de l’urbanisation. L’éloignement permet l’idéalisation. Les gens en ville ont un rapport très abstrait avec la nature. Et quand ils y sont vraiment confrontés, elle leur paraît souvent inacceptable. On m’a raconté l’histoire d’enfants qui, allant pique-niquer en forêt, sont épouvantés de voir qu’il y a des fourmis qui se promènent en liberté... La nature réelle, avec tout ce qu’elle compte de violence, d’incohérence, d’altérité, est insupportable pour nombre d’urbains qui en sont très très loin. Donc l’image pasteurisée, standardisée, donnée par la représentation publicitaire, apparaît comme une médiation nécessaire. L’image de la nature est remodelée pour être acceptable, pour correspondre aux standards. Or non : ce n’est pas ça, la nature. Un aspect particulièrement intéressant du Salon se rapporte à la construction de l’image animale. Notre époque a réparti les espèces en catégories étanches : l’animal de production — machine à fabriquer des protéines — auquel on refuse toute dignité, l’animal de compagnie, asservi à de redoutables contraintes anthropomorphiques (je pense au confinement en ville, aux eaux de toilette pour chiens et autres simagrées), enfin l’animal « sauvage » qui fait l’objet de tous les fantasmes. Finalement, ce dernier ne s’en sort pas si mal, même s’il y a la chasse.

Précisément : vous êtes conservateur du musée de la Chasse et de la Nature. Les chasseurs échappent-ils à cette vision mythifiée de la nature ?
Non, mais l’utopie est autre. Un livre de l’ethnologue Sergio Dalla Bernardina, Dans l’utopie de la nature, renvoie dos à dos les chasseurs et les écologistes, en montrant que paradoxalement, leurs représentations de la nature ne sont pas opposées. Les chasseurs, pour exercer avec bonne conscience et plaisir leur pratique, ont besoin d’imaginer une nature sauvage, une sorte de lieu primitif où l’on rencontre de vrais animaux — ce qui est de plus en plus rare, puisque maintenant le monde rural est complètement parcellisé, le gibier de chasse est souvent un gibier d’élevage. Et les écologistes, comme la plupart des contemporains, fantasment la nature, notamment l’espace sylvestre, la forêt... qu’ils voient comme un lieu primitif, échappé à la civilisation, alors qu’en fait ce sont partout des cultures d’arbres. La nature, en Occident et dans l’ensemble de la planète, est inconcevable sans l’action de l’homme, c’est un produit de la civilisation. Et nombre d’animaux « sauvages » (comme les cerfs) ne subsistent sur notre territoire que grâce aux efforts des hommes, et notamment des chasseurs, pour préserver leurs espèces.
Poursuivons sur la chasse : l’histoire des sensibilités montrerait sans doute une évolution parallèle de la vision nostalgique de l’agriculture et du rejet de la chasse...
Je ne suis pas chasseur — mais je mange de la viande et j’ose dire que j’aime ça. Et je suis souvent agacé par les critiques, souvent primaires, ou épidermiques, par rapport à la chasse. C’est quelque chose qui me fait réagir.

Vous voulez dire qu’on refuse la chasse de même que l’on refuse l’idée de la mort de l’animal dans l’industrie agroalimentaire. On se contente de regarder la jolie vache de l’affiche.
Oui. Cette tendance n’est pas nouvelle, mais elle s’accentue du fait de l’urbanisation de la société. La distance prise par rapport à la nature renforce une conception anthropomorphique : l’animal est vécu comme un semblable ; dès lors, comment peut-on tolérer de prendre plaisir à tuer un semblable ? C’est le grand problème de la chasse. Certains accepteraient qu’elle soit exercée, mais uniquement pour réguler les espèces. Tuer l’animal serait permis, à condition de ne pas y prendre de plaisir. Une fois de plus, une proposition de loi visant à interdire la chasse à courre vient d’être déposée [n.d.l.r. : le 5 février, par les députés Maxime Gremetz, Pierre Gosnat et Nicolas Dupont-Aignan]. C’est d’autant plus aberrant que de toutes les formes de chasse, elle me semble la plus défendable. C’est un fait culturel extrêmement élaboré, correspondant à une tradition ancestrale et qui exerce des prédations très limitée sur le gibier. Mais elle est rejetée de manière virulente, sous le prétexte subjectif que « c’est cruel ».
Car l’agriculture tue, et de façon cruelle, elle aussi...
Précisément, et c’est pourquoi les positions anti-chasse sont absurdes : elles abordent un problème extrêmement marginal face à l’exploitation de l’animal dans le monde agricole, dans des formes d’élevages qui sont indignes. Le discours sur la souffrance animale est hasardeux : car que sait-on vraiment à ce sujet ? Dans l’opinion majoritaire des contemporains, la douleur est fonction de son caractère spectaculaire ! On fait des gradations de douleur : ainsi, le bébé phoque qui saigne dans la neige souffre plus que la vache dans l’abattoir. Le cerf que l’on chasse souffre plus que la poule élevée en batterie. Pour ma part, je serais bien incapable de dire cela.
N’est-ce pas là quelque chose de très récent, et symptomatique de notre époque ? Un refus de l’idée même de la mort — tout un chacun, hormis quelques rares végétaliens, continuant à manger de la viande ?
On a pu dire que la chasse est l’un des derniers endroits de la civilisation contemporaine où la mort s’exerce en public. La mort est taboue de nos jours. Elle ne fait plus partie du spectacle de la vie quotidienne : on meurt dans les coulisses. À la chasse, elle est ritualisée, elle se donne à voir : et, au fond, c’est cela qui la rend inadmissible.

Pourquoi y a-t-il si peu de discours sur la question, hormis « la chasse c’est mal » ? On a l’impression que l’animal est un débat éludé... Le problème des chasseurs est peutêtre de n’avoir pas su intellectualiser leur pratique. Il ne faut pas que je le dise trop parce que je suis quand même entouré de chasseurs... Ils ont un peu loupé le coche. Des maisons comme la nôtre ont cette vocation, celle de lieu de rencontre et d’échange pour pacifier le débat.
Pour revenir sur la question de la mort : j’avais été stupéfaite, en 2007, par le traitement médiatique du documentaire de Nicolas Geyrhalter, Notre pain quotidien, sur l’industrie agroalimentaire...
C’est là qu’il y avait les poussins ?
Oui, c’est là qu’on voit les poussins qui tombent vivants, comme des billes, sur un tapis roulant...
Oui, un passage épouvantable. L’animal-chose...

Hormis les commentaires sur la valeur artistique de l’œuvre, l’ensemble des médias était comme médusé. On voyait l’impossibilité d’un discours : « c’est horrible —oui mais... »
« — Oui mais on fait quoi ? »
Voyez-vous une issue à ce mouvement inexorable ? Pourra-t-on éternellement renvoyer dos à dos l’image et le réel ?
Sincèrement, je crois que ce serait une telle remise en cause du système que je ne suis pas très optimiste... je ne suis pas sûr qu’elle se ferait de manière sereine. Pour tout dire, je crois que ce sont des problèmes de riches. Des problèmes qui ne se posent que dans des sociétés postindustrielles, qui devront faire face, de gré ou de force, à d’autres choses — sans vouloir être prophète de malheur. La conceptualisation de la nature pourrait ne plus être un problème d’actualité. Une telle mise à distance de l’image de la mort et de la souffrance peut retomber d’un seul coup, à tout moment.
Notre pain quotidien
Sorti en France en 2007, le documentaire de l’autrichien Nicolas Geyrhalter montre les techniques de l’agriculture intensive européenne, sans aucune voix off, à travers une série de longs plans fixes — chaînes de montage, ouvriers au travail, abattage... La critique fut unanime sur la beauté visuelle des images ; et perplexe sur le contenu, comme pétrifiée de culpabilité. Ainsi Vincent Ostria (Les Inrockuptibles) : « Ce qu’on voit est à la fois effrayant et révolutionnaire. [...] Le film expose implicitement une contradiction liée à notre survie. Comment faire puisque c’est grâce à ces immenses usines de produits végétaux ou animaux qu’on peut se nourrir à moindre coût ? Revenir à une production à échelle humaine aurait des répercussions conséquentes sur notre porte-monnaie. Mais foin de débat économico-politique. » Ou encore Première, pour qui le documentaire se situe « entre science-fiction et film d’horreur », dont le constat final est : « on se dit que l’on n’a plus faim. Et qu’un monde où l’horreur économique est ainsi perpétrée ne peut pas être le nôtre. » Certains, comme Télérama, s’en sortant par une pirouette : « Terrifiant panorama d’une industrie devenue folle, Notre pain quotidien nous convie à l’ultime bombance, un vrai repas de funérailles. » Dans tous les cas, c’est le déni de la possibilité d’un débat sur le terrain de la politique, de la législation, qui frappe... Il ne reste alors plus qu’à fermer les yeux.


Ci-dessus :
Photographies extraites du documentaire de Nicolas geyrhalter, NOTRE PAIN QUOTIDIEN, 2005 (Diffusion France : Kmbofilms)
les photographies du Salon de l’agriculture de Rémy Artiges ont donné lieu à une exposition au musée de la Chasse & de la Nature ainsi qu’à deux ouvrages : Rémy Artiges, Nature ®, Gang, 2010. Rémy Artiges & Laurence Cossé, La terre avait séché, Gallimard (collection Le Promeneur), 2010.
Notes bibliographiques : Le Chasseur et la Mort, colloque organisé par le Conseil international de la Chasse, La Table Ronde, 2005. M.& M. Pinson-Charlot, La Chasse à courre, ses rites et ses enjeux, Payot, 1993. Sergio Dalla Bernardina, L’Utopie de la nature, Imago, 1996.