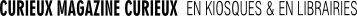


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


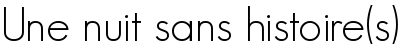
Encore aujourd’hui, dans l’immense majorité des témoignages, Nanterre, c’est l’Enfer gris. Les lits superposés, les vols et violences, l’ivresse et la promiscuité... (je ne fais là que « colporter »). De l’avis des travailleurs sociaux, la situation ne cesse de s’y améliorer, mais c’est loin d’être le Pérou. Seulement, je ne suis pas le premier : un documentariste glissé dans la peau d’un SDF s’y est introduit pour Canal + avec une caméra [1] ; Patrick Declerck, un ethnologue qui a longtemps travaillé sur les sans-abri, y a fait des incursions, qu’il narre avec une générosité de détails dans Les Naufragés [2]. Si le récit de sa première nuit ne vous a pas donné la nausée, l’avortement de la dernière déclenchera les balises de détresse. Adieu, les « papis » de quarante ans ; bonjour, les jeunes d’Europe de l’Est qui jouent du canif comme du yo-yo. Réticence à « affronter » des très jeunes (à peine plus jeunes que moi). Appréhension, aussi, d’être « démasqué », passé à la question, stigmatisé à mon tour... Et puis qui dit que le 115 m’enverra directement voir cette terre de mission à l’envers ? Sur la liste des réservations, il arrive loin derrière les deux étoiles d’Emmaüs, et celui qui demanderait Nanterre en premier choix se ferait regarder de travers...
Une fois mon envie d’exil entre parenthèses, trois sujets retiennent mon attention. D’abord, les maraudes effectuées dans Paris et banlieue (et jusqu’à Roissy) par les associations de secours... Des tournées qui durent toute une nuit, à pied ou en vélo, non pour ramasser des clochards mais pour établir un contact. Les maraudeurs qui font cela, quotidiennement, depuis parfois cinq ou dix ans, « commencent à connaître » les habitués. L’idée est de talonner l’un d’eux. Le portrait d’un travailleur social, qui exerce la nuit, non comme un lycanthrope (homme-loup), mais pour protéger et rassurer les loups. Le récit de la nuit, entrecoupé de longs moments de parole. La période où j’écris - quand j’essaie de caler ce sujet, nous sommes début avril - n’est pas idéale : le campement des Don Quichotte vient officiellement de se lever, et les associations ont permis à leurs équipes de maraudeurs, très investies sur le canal, de lever le pied quelque temps. Vous devrez donc attendre le mois prochain pour lire ce « reportage choc et sensationnel sur la lèpre des rues parisiennes »...
Deuxième piste : suivre une des familles, souvent sans papiers, logées par la mairie de Paris dans des hôtels Formule 1 en bordure de périph’ parce qu’on ne sait pas trop quoi en faire. Les Formule 1 tombent en décrépitude. Vu la situation et la quasi-absence de personnel, certains sont vite devenus des hôtels de passe. Le groupe de loisirs Accor, leur propriétaire, ne rêve plus que de s’en débarrasser. Pour des raisons qui m’échappent (tourisme périurbain, nostalgie de la petite ceinture, hygiène et aération des bâtiments ?), on a instauré un système de jachère : les familles tournent entre plusieurs hôtels, certaines depuis des années. Le système coûte des fortunes à la ville. Mais un tel reportage se conçoit dans la durée : ce qu’on appelle le « droit de suite » - aller revoir les gens qu’on a rencontrés pendant une enquête pour suivre l’évolution des événements -, il ne faut pas attendre la fin du reportage pour l’appliquer. J’escompte intercepter la même famille à Ivry, Massy ou Saint-Denis, pour donner des photographies du « paysage » (géographique et humain).
Au final, je décide de passer une nuit dans un centre d’hébergement parisien... en compagnie du « tôlier » : un permanent d’association. Je n’ai demandé aucune autorisation, je m’introduis un peu en contrebande. J’ai expliqué mon projet général à celui que j’accompagne, mais sous-estimé l’« intégration » des résidents : je m’attendais à trouver un lieu ouvert à tous vents, assailli de demandes, refusant des arrivants tout au long de la nuit ; je trouve un système géré très en amont, avec des gens sur place depuis longtemps, et des horaires stricts de fermeture des portes. Plutôt que de jouer la bête - me faire passer pour SDF, ce qui serait excellent pour écrire sur la vie au centre, mais déplorable pour recueillir d’autres bribes de vie -, je me poste à l’accueil, espérant voir défiler les locataires. Une position qui trouve vite ses limites, tant elle aurait requis de préparation en amont. Établir le contact et un minimum de confiance, sinon de reconnaissance, avec les locataires comme avec la poignée de travailleurs sociaux qui se succèdent ici durant une semaine. Faire du lieu, sinon mon « camp », du moins une base. Une méthode quasi « documentaire », rien que pour commencer à connaître les gens, à les voir agir et à avoir quelques fragments d’histoire(s)... Avec les risques que ça induit : déborder, par exemple, sur la vie et les états d’âme de l’association (les différentes structures d’aide sont plus ou moins « moralisatrices », militent plus ou moins pour le retour au travail... certaines considèrent que c’est leur rôle, d’autres pas). C’est bien plus délicat de questionner ici que dans la rue. Ces gens font leur vie en ces lieux, quelques mois voire quelques années. La moitié parle mal français, ou avec un accent malaisé à comprendre. Impossible de livrer un « reportage ». Au mieux, une pièce de théâtre, un carnet de bord, relevé d’annotations marginale, et à mon avis anodines, regrettable dans la mesure où je ne sais rien des gens que j’ai vu défiler. À peine un prénom.
Je suis dans un ancien hôtel, doté d’une cinquantaine de chambres, dans un ancien quartier d’eaux. Depuis quelques jours, les centres ouvrent 24 heures sur 24. C’est la phase de « stabilisation » ; les locataires ne sont plus obligés de décamper à 8 heures du matin... Ils se sentent davantage chez eux, et du coup ont fait un peu de grabuge les premières nuits. (C’est l’une des effets du mouvement du canal, après lequel un gros effort a été entrepris : cinquante bungalows construits à Ivry, et de nouveaux centres - provisoires - ouverts dans le XIIIe, le XIVe, le VIe...) Quand je prends mon « tour » à vingt-deux heures, la salle télé est pleine. Les gens ne sont pas en pyjama, et pourtant on croirait une classe verte, ou une grande famille. Si un jeune fou ne semait pas la discorde en demandant, au milieu d’une assemblée essentiellement noire, si quelqu’un est né en Afrique (« moi je suis né à Alger la blanche ! Je suis le roi du monde... »), le plus parfait calme régnerait. Tous regardent dans la même direction (la télé), les hommes assis sur trois canapés, et une femme, sur une petite chaise, en vigie, à leur gauche.
A vingt-deux heures, c’est la relève des permanents : carnet de liaison (où sont relevés les moindres faits notables, absences et retards, ou incidents), cuisine et bureaux interdits aux locataires, inspection des caves, sarabande du téléphone, tel ou tel hébergé prévenant de son absence ou demandant s’il n’y a pas un lit pour un ami... Par l’immeuble transitent aussi des voisins. Le centre se vide d’un seul mouvement, une heure après mon arrivée ; il est vingt-trois heures, et tout le monde se couche après la fin de la série. Les quelques oiseaux de nuit cochent leur nom sur la feuille de présence. J’ai une grande surprise en voyant rentrer un monsieur corpulent dans un impeccable costume à rayures, très élégant avec sa fleur orange à la boutonnière. Un grand nombre de locataires, en effet, travaille. Une partie se permet même de payer le loyer, symbolique, prévu par le règlement. Certains n’ont jamais vraiment été SDF, mais sont arrivés ici après avoir perdu famille ou appartement. Jusqu’au lendemain, huit heures, les mouvements seront limités. Quelques-uns stationnent encore dans la cour. Un autre demande l’autorisation de sortir dix minutes, tout en s’enquérant de ses draps, pas changés depuis un mois. Mis à part quelques inspections du veilleur « de jour et de nuit » dans les étages, il semble que rien ne bougera plus cette nuit-là.
Le lendemain, une poignée de personnes partent sur les chapeaux de roue, avant six heures du matin. À sept heures commence le petit déjeuner (un rituel, comme le repas du soir). Chacun vient prendre sa demi-baguette (fraîche) à la cuisine, surveiller la cuisson du lait, saluer le permanent... Certains pressent le tempo, déchirant les bricks de lait avec leurs dents pour être sortis plus tôt. Les hébergés passent devant la télévision allumée. S’attardent. Retardent le moment de sortir. L’objet a l’air rassurant : c’est presque un second foyer - pour les surveillants comme pour les locataires. À sept heures et demi, l’un d’eux suit les conseils de mode de Télématin et zappe quand apparaît Sarkozy, invité politique du matin. On ne discute pas. Tout est dit.