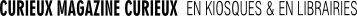


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


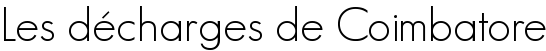
 |
|
|
Publié dans le
numéro 05 (10-23 avril 2010)
|
En décembre dernier, j’arrive à Coimbatore, ville d’un million d’habitants de l’Inde méridionale, aux confins du Tamil Nadu et du Kerala. But de mon séjour : suivre, dans le cadre de mes recherches de doctorat, les tribulations de ces matières délaissées qu’on appelle les déchets ménagers.
Un relais auprès d’une des universités de la ville me permet de bénéficier de l’aide de deux étudiantes tamoulophones ainsi que d’une introduction formelle auprès des autorités municipales. Ayant reçu un précieux laisser-passer des mains du plus haut responsable de la Coimbatore City Municipal Corporation (CCMC), je rencontre très vite les responsables du service de gestion des déchets.
La gestion des ordures municipales fait, en Inde, l’objet d’une attention relativement nouvelle de la part des pouvoirs publics. Le Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (NURM) est un programme fédéral, lancé en 2005, destiné à financer des œuvres d’infrastructures urbaines dans les soixante plus grandes villes du pays, dans le but d’en faire des « world class cities ». Ce dispositif, d’une ampleur colossale (500 milliards de roupies sur sept ans, soit environ 8 milliards d’euros) finance en particulier des projets de gestion durable des déchets.
Pour parvenir aux locaux du NURM, je traverse les méandres du bâtiment d’administration municipale : couloirs, escaliers, bureaux où s’empilent des centaines de dossiers agrafés, vieilles armoires bringuebalantes aux portes entrouvertes, ampoules nues, ascenseurs détraqués et tout un capharnaüm de tampons, de machines à écrire, de meubles en bois portant le sceau de Shiva, trois bandes parallèles de craie.
Une fois traversé ce décor habituel de la fonction publique territoriale indienne, je débouche sur des bureaux situés à l’arrière du bâtiment : carrelés, vitrés, propres, rutilants. Des boxes en contreplaqué d’un genre de pin finlandais, des ordinateurs récents, des sièges molletonnés sur roulettes (dont l’emballage plastique moulant n’a pas été retiré, afin d’en retarder l’usure). Il s’agit toujours de la même organisation, mais l’inscription récente des préoccupations environnementales au programme d’investissement du NURM se devine ne serait-ce qu’à la fraîcheur de l’air propulsé par les machines à air conditionné. Un responsable me reçoit, nous échangeons quelques propos polis tout-à-fait vagues, irréalistes et politiquement corrects sur la collecte des déchets, puis il me propose d’accompagner l’un de ses techniciens pour une visite de terrain.
Le surlendemain matin, Ravi Kannan, trentenaire à pantalon à pinces et blanche chemise, me fait monter à bord d’une jeep conduite par un chauffeur, direction le site d’enfouissement des déchets de Vellalore, à quinze kilomètres au sud du centre-ville. Vellalore est le lieu de l’actuelle décharge de la ville, mais également le site du futur centre de traitement et d’enfouissement des déchets conçu et financé dans le cadre du NURM. Après avoir traversé quelques villages et surmonté bon nombre de dos d’âne, nous arrivons à l’entrée du site.
Une décharge est une lande reconnaissable entre mille : les arbres et buissons agitent des branches dont les feuilles d’un vert grisâtre bruissent au contact des sacs plastiques que le vent y a projetés, l’air semble comme enduit d’une nappe oléagineuse qui colle à la peau (il fait une trentaine de degrés) et, au loin, des rapaces planent et tournent dans les airs. Nous y sommes.
La jeep poursuit sa route et s’enfonce dans une vaste plaine couverte de dunes, de tas, de buttes blanches, grises, marron. Ci-gît un amoncellement indistinct de débris aux couleurs passées, mates et métalliques sous le ciel immobile. Ailleurs des taches de jaune, de rouge, de bleu, quelques touffes d’herbe. Qu’est-ce ? Difficile à dire... Ce ne sont pas, pourtant, les mots qui manquent : des ordures, de la boue, de la crasse, des décombres, des épaves, de la fange, des gravats, des immondices, de la mélasse, des riblons, des scories... En somme : des poubelles ! De la matière organique à des stades variés de putréfaction, mais aussi du plastique, beaucoup de plastique, du carton, des morceaux de métal, des débris de verre, du bois, du papier, des néons, des pneus, des débris de brique, et tout un tas de matières indiscernables.
D’habitude, une décharge, c’est plutôt un amoncellement de résidus déversés par des camions au fond d’un ravin. Ces poubelles-ci ont été sciemment étalées à l’horizontal, afin d’en dégager les gaz captifs, le fameux méthane (CH4), si prompt à enflammer le tout et qui renforce l’effet de serre. Une fois les déchets retournés, une partie a été tassée de manière à faire surgir une montagne de résidus et de terre mêlés, d’une quinzaine de mètres de haut.
La jeep suit le chemin tracé dans cette pyramide de l’immonde pour nous permettre d’en atteindre le faîte. Je parcours les dernières centaines de mètres à pied, sous une chaleur étouffante et, toujours, cette chape de résine humide qui me colle à la peau. Le sol sur lequel je marche est constitué de terre compactée, dans laquelle sont imbriqués et dépassent tout un tas de trucs et de machins ayant perdu forme et parfois même consistance.
En haut, évidemment, toute une petite foule d’êtres disparates s’affairent. Il y a d’abord les corbeaux et autres rapaces qui claudiquent sur deux pattes, observent, s’envolent, se posent un peu plus loin et furètent de leur bec crochu dans les détritus. Il y a ensuite la poussière soulevée par le défilé régulier des camions qui déchargent le contenu de leur benne au sommet du monticule avant de s’en retourner vers la ville. Sur place, des agents municipaux veillent à l’intégration des derniers éléments apportés au rebutant édifice. L’un d’eux conduit un tractopelle et égalise le tas, puis le comprime en l’écrasant de ses lourdes chenilles. Et ainsi, inlassablement. En contrebas, une irrégularité dans le pâté des hommes a créé une petite dépression où s’est accumulée l’eau de pluie. Une flaque, noirâtre, s’est formée. Un cloaque. Deux chiens errants traînent à ses abords. L’un s’y trempe.
Enfin, il y a les chiffonniers, les biffins, les boueux, les gadouilleurs. En anglais : les ragpickers ou scavengers. Ce sont des miséreux, des gens de rien, des intouchables, ici des migrants de l’Orissa. Ils sont maigres et de petite taille, la peau très foncée, vêtus d’habits en lambeaux, sans la moindre protection. Ni contre le soleil, ni contre les ordures qu’ils inspectent. Ils s’activent sur le tas sans se laisser de répit. Ils sont une douzaine et très organisés. Ils se jettent, armés de crochets et de grands sacs, sur les tas d’ordures fraîchement déversées, avant que la machine jaune ne les écrabouille. Ils farfouillent, cherchent et glanent les matériaux qu’ils peuvent récupérer. Ils les entassent ensuite dans de grands sacs en plastique différenciés : métaux d’un côté, plastiques de l’autre, papier-cartons, verre, objets. Une fois remplis, ces gros sacs blancs sont chargés à bord d’une charrette tirée par un tracteur.
Les ragpickers arrivent tôt le matin et quittent les lieux vers midi. Depuis que la Municipalité a décidé d’améliorer la gestion des rejets de la ville, leurs activités sur la décharge sont contrôlées. De manière générale, la politique nationale a pour effet de circonscrire et de restreindre l’accès à ces zones auparavant abandonnées - et partant libres d’accès.
Si les décharges étaient jadis ouvertes, ce n’est plus le cas aujourd’hui, ni à Vellalore ni dans les autres décharges de la ville, plus anciennes, dont la plupart ont été « réhabilitées ». À Kandanpalayam, les ordures ont été brassées, puis tassées en une colline d’une douzaine de mètres de haut et très pentue. Cette colline de déchets a été enveloppée d’une membrane imperméable. Des tuyaux permettent d’en évacuer le gaz qui serait resté captif. La membrane a été recouverte de terre sur laquelle les responsables municipaux ont fait pousser du gazon. Grimper dessus est interdit. Deux policiers montent la garde au sommet de cette green area. Du fait de mon accréditation officielle, une dérogation m’est accordée. En haut, une femme en sari accroupie prend soin d’une rangée de fleurs d’un jaune pâle. La vue sur les quartiers environnants est appréciable. L’immense terrain vague est désormais relativement présentable ; le projet des autorités est de le convertir en parc municipal. À y regarder de plus près, toutefois, quelques détails rappellent l’inquiétante particularité du lieu. À chaque pas dans l’herbe qui recouvre ce monticule, une foule de minuscules pucerons blancs jaillit. Et des espèces de très fines toiles d’araignées blanchâtres s’épanouissent entre les touffes...
Dans les rues de la ville, les traditionnelles community bins, vastes conteneurs collectifs où les gens venaient jeter leurs résidus - et toutes sortes de personnes et d’animaux glaner des morceaux valables - ne sont plus les réceptacles privilégiés de l’expulsion matérielle ménagère. Les foyers se sont vus distribuer deux petits bacs, l’un vert, l’autre blanc, destinés respectivement aux ordures organiques et générales. Leur ramassage en porte-à-porte par les autorités publiques, qui est en train de s’instaurer, court-circuite les ragpickers, dont l’activité quotidienne consiste à parcourir les rues de la ville à la recherche de déchets.
Privés d’une partie de leur butin par le ramassage municipal, les ragpickers sont également concurrencés par d’autres individus. Il s’agit des commerçants ambulants, les kabadiwallahs, qui, à Coimbatore comme dans toutes les villes de l’Inde, sillonnent les quartiers pour y récupérer des matériaux et objets. Mais ceux-là ne se contentent pas de ramasser ce dont les citadins se débarrassent : ils le rachètent. Tous les ménages mettent ainsi de côté leurs vieux journaux, bouteilles en verre et objets en plastique, sachant qu’ils vont pouvoir en tirer un petit bénéfice auprès de ces colporteurs réguliers.
Nous atteignons ici l’une des contradictions de la situation actuelle en Inde : les municipalités mettent en place un système de ramassage et de stockage des déchets et entendent, pour cela, prélever une taxe auprès des citadins, qui deviennent alors usagers d’un service. Dans le même temps, des commerçants du secteur informel rendent peu ou prou le même service aux citadins, en les débarrassant de résidus d’objets, devenus inutiles et encombrants, mais proposent de rémunérer les habitants pour cela. De sorte que, sous prétexte d’une gestion rigoureuse d’un point de vue environnemental, les autorités publiques privent de leur unique source de revenus un nombre considérables de travailleurs informels. Il est certes permis de considérer que ceux-ci sont la manifestation d’un système D voué à disparaître dans le sillage de la « modernisation ». Ce destin peut cependant être questionné à deux niveaux. N’est-ce pas là nier l’efficacité économique des filières de récupération informelles ? Et le fait de rendre ce service depuis des décennies ne leur confère-t-il pas une certaine légitimité vis-à-vis des autorités publiques qui viennent tout juste de prendre conscience du problème ?
Cette concurrence acharnée prouve une chose : une partie de ce qu’on nomme d’ordinaire « déchets » demeure, aux yeux de nombreux acteurs, un matériau non dépourvu de valeur. Dès lors, cette notion perd de sa clarté : qu’est-ce qu’un déchet ?
Étymologiquement, le déchet renferme l’idée de déchéance, de perte, issue du verbe déchoir. Il évoque de surcroît la saleté, la puanteur, le dégoût : c’est l’ordure, du latin horridus, « négligé, repoussant, hideux », et l’immondice, du latin immondus, « sale, impur, qui n’est pas propre (mundus) ». L’histoire, toutefois, ne s’arrête pas là. Souvent, ce qui est jeté par l’un se révèle désiré ou intéressant pour un autre : le déchet n’est pas seulement rebut, il est aussi ressource. C’est une question de perception, d’angle de vue. Les artisans le savent bien, une chute - de tissu, de bois - n’est pas nécessairement sans utilité.
Mais alors à quel moment un objet devient-il un déchet ? Si on suit l’exemple des flux de matières à Coimbatore, il semble qu’une dimension spatiale intervient dans ce processus. Tant que les habitants conservent leurs détritus à l’intérieur de leur maison, ce sont des biens, potentiellement monnayables ; mais s’ils les sortent et les placent à l’extérieur de leur maison, ce sont des déchets. Cela rejoint le travail de l’anthropologue Mary Douglas, selon laquelle le caractère polluant d’une chose tient moins à ses caractéristiques physiques qu’à son emplacement : ce qui est sale, c’est ce qui n’est pas à sa place. Ainsi, une cuillère pleine de chocolat dans une casserole ne gêne personne ; mettez-la sur un lit, elle change de statut.
Une question de perception, d’ordre, de propriété aussi. Revenons sur le cas de Coimbatore. Tant qu’ils demeurent dans la maison, les rebuts peuvent être revendus : leur producteur en est toujours propriétaire. Dès qu’ils en sortent, ils deviennent déchets, c’est-à-dire res nullius, « ce qui n’appartient à personne ». C’est à la puissance publique de les prendre en charge et ce service est assorti d’un impôt.
Nous voyons bien que la définition du déchet n’a rien d’immanent, elle découle d’une organisation sociale, économique et spatiale bien précise. En Inde, ce système de gestion/définition est en cours de construction. En France, il est davantage stabilisé. Les ordures, ce négatif de notre développement, y représentent un monde de l’ombre, refoulé. Nos fantasmes technicistes nous conduiraient d’ailleurs volontiers à l’évacuer par aspiration pneumatique, comme de l’eau usée, par un système de canalisations enterrées, tel qu’il a été expérimenté à Narbonne par exemple. C’est le prolongement du vide-ordures : le sac poubelle que l’on jette de chez soi serait aussitôt aspiré sous terre, transporté, trié, recyclé, valorisé...
La réalité est pourtant bien différente. Depuis la loi-cadre de 1975, la gestion des déchets ménagers en France a beaucoup évolué. Nous vivons dans une société tournée vers la production de services et d’objets, le « triomphe de l’obsolescence », pour reprendre la formule de Susan Strasser [1], étant devenu depuis le milieu du XXe siècle la source principale du dynamisme économique. Ce principe induit nécessairement un impératif d’élimination des produits obsolètes. De fait, nous sommes, dans le même temps, de plus en plus mis à contribution pour réduire les dégâts de l’existence post-consommation des produits que nous utilisons.
Or le terme d’« élimination » est fallacieux. In fine, les déchets ne sont pas éliminés : ils sont enfouis. On creuse un trou, on le remplit de déchets, puis on le rebouche. Si le principe n’a guère changé, la technique a certes évolué : on surveille aujourd’hui les infiltrations liquides dans le sol et les émanations gazeuses dans l’atmosphère. L’incinération non plus ne fait pas disparaître les déchets, puisqu’elle les réduit au mieux au tiers de leur masse initiale. Non seulement les déchets ne disparaissent pas, mais - ironie du sort - le fait de construire des installations sophistiquées et coûteuses pour les réduire et les enterrer encourage les exploitants de ces unités à les remplir au maximum, en vue d’en maximiser la rentabilité. C’est la porte ouverte à une production sans retenue de déchets.
Or parallèlement, on nous prie de trier, c’est-à-dire de détourner certaines matières de ce flux destiné à l’incinération et au stockage. En tant que citadins, nous nous y plions, en râlant plus ou moins. Mais, après tout, trier permet de jeter sans compter tout en ayant bonne conscience. Puisque c’est recyclé, à quoi bon modérer sa consommation ? Et d’ailleurs, est-ce vraiment recyclé ? Une légende urbaine a ainsi la vie dure : le contenu des camions de la collecte sélective serait en fait re-mélangé ! Je m’échine à jeter 2 ou 3 types de déchets dans des bacs distincts, mais qui me dit qu’une fois collectés, tous ces compartiments ne sont pas déversés ensemble... ? Hors pannes très ponctuelles, c’est faux : les filières sont respectées.
S’il s’agit de questionner l’impératif moral qui accompagne le recyclage (« ne pas trier, c’est mal »), les enjeux se situent à une échelle toute autre. Tout d’abord, dans les pays riches comme le nôtre, les déchets ménagers représentent à peine plus de 5%, en poids, de l’ensemble des déchets engendrés. En ce sens, le recyclage ménager ne vise que la partie émergée de l’iceberg. Or, en dépit d’incitations fiscales qui se durcissent, les déchets industriels sont encore peu triés.
Le leurre du recyclage réside ensuite dans le fameux « point vert ». Vous savez, ce logo - deux flèches courbées et inversées dans un cercle- apposé sur nombre de produits de consommation. Il ne garantit nullement que l’objet soit recyclable. Pensez-vous ! Il indique simplement que son fabricant contribue au financement global des filières de recyclage. Ainsi les industriels français s’achètent-ils une image « écolo-friendly » à bon compte : ils ne s’engagent pas à produire des biens recyclables et, de surcroît, ne financent que 30 à 50% du coût de collecte et de traitement des déchets recyclables - contre 100% en Allemagne.
Enfin, bien loin de générer des recettes, le recyclage peut représenter un coût pour les collectivités. Le système mis en place pour les ramasser séparément, les transporter, les trier, les revendre est lourd et onéreux. Le tri est souvent mal fait par les habitants : un quart des déchets arrivant en centre de tri sont impossibles à recycler et partiront en enfouissement. Et tous les matériaux ne rencontrent pas le même succès à la revente : malgré un doublement des quantités collectées entre 2000 et 2007, les plastiques usagés continuent de n’être que faiblement recyclés et ne génèrent guère de recettes.
Bien sûr, le recyclage des matériaux évite d’énormes extractions de matières premières et destruction d’écosystèmes. Nous utilisons de plus en plus d’objets fabriqués à partir de matières premières « secondaires » (MPS), ce qui évite autant de consommation de matières premières vierges, extraites souvent à l’autre bout du monde. Ainsi l’incorporation des MPS dans la production nationale a-t-elle progressé de 5,5 % par an en moyenne entre 1995 et 2000, selon le Service de l’observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable [2]. Depuis 2000, toutefois, le tonnage de MPS utilisées stagne : il n’a augmenté que de 0,5 % par an entre 2000 et 2007.
En fait, pour résumer, les politiques publiques de gestion des déchets en France ont mis trente ans à passer du traitement en aval (incinérateurs, centres de stockage...) au problème lui-même : la consommation. Aujourd’hui, une alternative s’offre à nous : écologie industrielle vs réduction des déchets. Deux voies qui ne sont pas forcément incompatibles, mais peuvent se révéler contradictoires.
La première correspond aux démarches de recyclage des rebuts. Elle consiste à progresser d’une économie très « linéaire », qui utilise beaucoup de ressources naturelles puis accumule des déchets, vers une économie plus « circulaire », incorporant le maximum de matières déjà utilisées dans la fabrication de nouveaux produits. Toutefois, le recyclage ne freine ni la croissance de la production, ni celle de la consommation d’objets ; au contraire. Et nos dispositifs de « valorisation » des déchets s’écartent encore de l’écologie industrielle telle qu’on la trouve matérialisée par exemple à Kalundbord, au Danemark, en ce qu’ils ne respectent pas le principe des circuits courts : proximité spatiale entre le producteur du déchet et le recycleur.
L’autre solution renvoie au nouveau mot d’ordre prôné par le Ministère de l’Environnement : « le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit ». La prévention se décline à deux niveaux : consommer moins, et donner une deuxième vie aux objets pour un usage identique à leur usage initial (consigne, réemploi, réparation, don). Curieusement, ce champ d’action est principalement investi par des acteurs de l’économie sociale et solidaire : Le Relais, Emmaüs, Croix-Rouge, Envie, mais aussi brocantes et plateformes d’achat-vente sur Internet (e-Bay, Freecycle). Réseaux qui au fond ne sont pas sans rappeler les commerçants informels de Coimbatore et manifestent l’émergence d’une économie informelle en France, dans la mesure où, à condition de ne pas faire de publicité, ils échappent à la TVA...
Peu de choses sont aussi omniprésentes dans nos vies que les déchets et aussi absentes du débat, ou même de nos consciences. Le système économique dans lequel nous vivons, articulé autour de la dialectique travail/capital, est focalisé sur l’extraction, la production, la distribution et la consommation. Après ? Le néant. Nul ne s’en soucie et pourtant la matière ne disparaît pas - même en fumée - elle reste là.
Notre rapport à nos déchets, pourtant, nous en dit long sur ce que nous sommes, individuellement et collectivement : « Jeter est la première condition indispensable pour être, parce qu’on est ce qu’on ne jette pas », écrit Calvino [3]. Nos ordures révèlent ce que nous sommes ... en creux. C’est d’ailleurs la base de la rudologie, science des déchets élaborée par Jean Gouhier : « dis-moi ce que tu jettes et je te dirai qui tu es ».
A l’opposé de cette organisation sociale, économique et écologique où la production est dissociée de sa finalité et où un objet, une fois utilisé, bascule dans l’im-monde, il y a ce Fragment n°124 d’Héraclite qui figure en épitaphe sur la première page du Tigre : « Un tas de gravats déversé au hasard : le plus bel ordre du monde ». Chez Héraclite, point de déterminisme matériel ; l’être est éternellement en devenir. Ce qui vit meurt, ce qui est mort devient vivant : le courant de la génération et de la mort ne s’arrête jamais. Un déchet peut aussi être le commencement de quelque chose de neuf.
Georges Bataille, dans un étonnant traité d’économie politique datant de 1949, [4] s’insurge contre l’ordre du monde apollinien et austère qui structure les sociétés modernes. Il développe une conception de l’existence fondée sur la conscience de la finitude de notre (milieu de) vie. Seule compte pour lui la dépense libre : le jeu, la fête, le sacrifice, l’érotisme. Des actes qui se situent aux antipodes de la « consommation ». D’après Bataille, tout le système productif et acquisitif n’a en réalité qu’une seule fin : la dépense improductive ! «La perte ostentatoire reste universellement liée à la richesse comme sa fonction dernière.» Seul le superflu, l’inutile, peuvent être le signe de l’abondance réelle.
Dans cette vision dionysiaque, la société peut avoir intérêt à des pertes considérables, pour atteindre un certain état généreux, démesuré. C’est un renversement de l’ordre bourgeois dans lequel nous baignons, où la règle morale veut que l’on cache ses dépenses. Notre société est hypocrite : non seulement elle repose sur l’exploitation humaine tout en proclamant une égalité abstraite, mais elle ne consent à aucune dépense somptuaire. Michel Tournier [5], à travers son Dandy des Gadoues, rejoint Bataille dans cette accusation : « Cloporte petit-bourgeois ! Toujours cette peur de jeter, ce regret avare face au rebut. Une obsession, un idéal : une société qui ne rejetterait rien [...] C’est le rêve de la constipation urbaine intégrale. Au lieu que moi, je rêve d’une déjection totale, universelle, qui précipiterait toute une ville au rebut ».
Bien loin des revendications d’élévation du pouvoir d’achat - qui n’est que l’existence asservie aux nécessités - ou de la honte du vieillissement, de l’anéantissement, de l’improductivité, Bataille et Tournier nous encouragent à placer les déchets, la destruction, au centre : cet excédent que la société produit, il faut le dilapider de façon gratuite. C’est la seule façon de sublimer cette « part maudite ».
[1] Susan Strasser, Waste and want : a social history of trash, New York, Henry Holt & Co, 2000.
[2] Service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable, « Recyclage et réemploi, une économie de ressources naturelles », Le Point sur, n°42, mars 2010.
[3] Italo Calvino, La route de San Giovanni, Paris, Seuil 1988.
[4] Georges Bataille, La Part maudite, Paris, Minuit, 1980.
[5] Michel Tournier, Les Météores, Paris, Gallimard, 1975